|
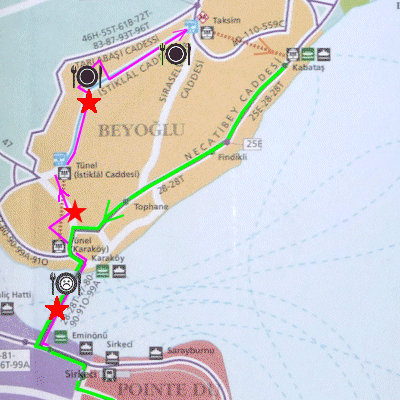
| ||||
| ||||||||
Retour
aux VOYAGES Etape
précedente : autour des Bazars (Sülemaniye...) |
Nous allons consacrer en gros un après-midi à la découverte du Pont de Galata et du quartier auquel il conduit, au nord de la Corne d'Or.
La Corne d'Or et le Pont de Galata
Les
deux rives de la Corne d’Or ont accueilli des populations variées
(sur les plans religieux, sociaux et ethniques) et différentes d'une rive
à l'autre et au cours des siècles. Un parfait reflet de la diversité
qui caractérisait l'empire ottoman.
D'un côté (sud), l'entrée
de la Corne d'Or est dominée par le vieux sérail de Topkapi et de
l'autre (nord) par la grande Tour de Galata, deux monuments qui symbolisent la
puissance du sultan et celle de l’empire commercial des Génois, c'est-à-dire
un quartier musulman avec les minarets des mosquées qui se dressent dans
le ciel et en face un quartier latin du commerce.
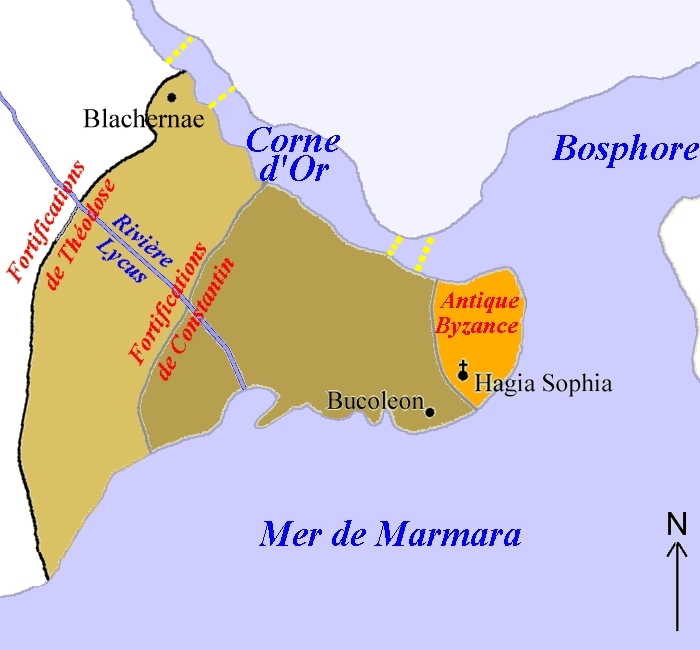
La
Corne d'Or constituait jadis un remarquable abri portuaire qui attira des colons
dès le VIIes. av. J-C. L'origine de son nom viendrait du fait que lors
de la conquête ottomane les riches Byzantins y avaient jeté leurs
objets précieux ce qui donnait son éclat doré aux eaux de
l'estuaire.
Bordé d'usines polluantes, la Corne d'Or a perdu de son
éclat (bien qu'au soleil couchant...) et bien évidemment ses dimensions
ne sont plus adaptées à celles des pétroliers, paquebots
et porte-conteneurs géants.
    | ||
| | |||
Près du Pont de Galata, rive droite de la Corne d'Or, on aperçoit la mosquée de Rüstem Pasa construite en 1561 pour le Grand Vizir de Soliman, oeuvre de Sinan qui parait bien modeste au pied de la mosquée de Süleymaniye qui l'écrase de son imposante silhouette, et même discrète par rapport à sa voisine, la Nouvelle Mosquée.
![]()
![]() PONT DE GALATA ET AUTRES PONTS
PONT DE GALATA ET AUTRES PONTS
Nous sommes là à un point névralgique, proche des bazars, de la Nouvelle Mosquée (importante sur le plan religieux), de la gare, des embarcadères, des banques et du passage traditionnel vers l'autre rive de la Corne d'Or. On est confronté ici à un flot de véhicules en tous genres et à une marée humaine.
Un
tout premier pont avait existé au temps de l'empereur Justinien au VIe s.
Au milieu du XIXe s.,
la sultane-mère Bezmialem (mère du sultan Abdülmecit) fit édifier
entre
Eminönü et Karaköy (Galata) un pont
dont le projet avait été conçu par le sultan Beyazit II
dès le XVe s. mais jamais réalisé. Il occupait la place
du pont actuel mais n'eut qu'une existence éphémère (18 années).
Abdülaziz fit construire en 1863 un nouveau pont plus grand que celui de
la sultane-mère, plus en amont sur la Corne d'Or, là où se
trouve l’actuel pont d’Unkapani ou Atatürk (Hayrat Köprüsü
devenu Atatürk Köprüsü en 1939).
Une
quinzaine d'années plus tard une société anglaise fut chargée
de bâtir un autre pont, flottant celui-ci, à l'emplacement de l'actuel
pont de Galata. Il fut remplacé par un quatrième pont en 1910-12,
allemand cette fois et à deux niveaux: le pont supérieur pour les
véhicules et le pont inférieur pour les cafés, restaurants
et marchands de fruits et servant également d'embarcadère. Il fut
détruit par un incendie en 1992.
Son successeur est donc l'actuel
pont de Galata (Galata Köprüsü), bâti en 1994,
et qui a reconduit le principe des deux niveaux. C'est un pont de 490 m de long,
dont la partie centrale du tablier est à bascule sur 80 m. Afin d'éviter
la fréquence de cette manoeuvre, les bateaux de promenade qui passent sous
son tablier sont démâtés ou plus exactement sont dépourvus
des superstructures habituelles.
Avec 42 mètres de large, il offre
trois voies de circulation et une voie piétonne dans chaque sens et l'on
a pu aménager récemment une voie pour le tramway. Les très
larges parties piétonnes longent les parapets qui sont accaparés
par les pêcheurs à la ligne. Evitez donc de vous faire accrocher
par un hameçon!
![]()
Le
niveau inférieur, mis en service en 2003, est consacré aux bars
et restaurants mais franchement c'est là que l'on peut trouver le pire
en matière de racolage et de mauvais rapport qualité/prix comme
nous aurons l'occasion de le constater un soir (au retour de notre échappée
dans le quartier d'Üsküdar)...
 | ||
Plus loin, au-delà des remparts de Théodose, le pont de la Corne
d'Or (Haliç Köprüsü) relie les périphériques
de part et d'autre de la Corne d'Or depuis 1996.
En position intermédiaire
un autre pont devrait voir le jour afin de relier les lignes de métro de
part et d'autre.
|
Pour
certains, le mot "Galata" a pour origine le terme italien calata
qui signifie "pentu" et s'appliquant bien à ce quartier construit
sur la pente d'une colline. Plus
sûrement on peut aussi évoquer le fait que pour les Grecs, Galat
désignait le peuple celte des Galates, autrement dit une peuplade venue
de Gaule, qui s'établit ici pendant la période hellénistique
pour s'installer ensuite en Anatolie. Les fameux Galates chapitrés ou plutôt
"épîtrés" par l'apôtre Paul... |
Au-delà
du Pont de Galata, au nord, sur la rive gauche de la Corne d'Or se dresse la colline
de Beyoglu dont les premières pentes correspondent au quartier de Galata
et la partie supérieure à celui de Pera.
C'est la ville occidentale
face à la ville orientale.
Quand les Paléologues récupèrent leur capitale
occupée par les Croisés depuis 1261 et par les Vénitiens
depuis 1204, ils eurent besoin, pour faire face à la toute puissante Sérénissime,
de l’aide de son ennemi héréditaire, la République de
Gênes. Cette alliance aboutit à une première concession accordée
aux Génois pour bâtir une cité sur l’autre rive de la
Corne d’Or. La Tour de Galata que nous allons bientôt évoqué
est un témoignage du système de défense alors mis en place.
La relative autonomie se maintint en partie après la conquête
de Constantinople par les Ottomans en 1453. Les Génois n’ayant pas
combattu et ayant livré les clefs de la ville de Galata à l’ennemi
signent un acte de reddition qui garantit non seulement leurs personnes et leurs
biens, mais leur donne aussi le droit de conserver leurs églises et leur
accorde une quasi autonomie.. Une autonomie plus formelle fut rétablie
avec les "capitulations" (au sens de "traités"
ou de "conventions") conclues au milieu du XVIe s. avec le sultan
Soliman le Magnifique, capitulations qui octroyaient aux ressortissants des pays
européens des droits particuliers (tribunaux, prisons) ainsi qu'aux nombreux
Juifs établis dans ce quartier. Ceci explique la présence de nombreuses
églises et synagogues dans ce quartier.
C'est une sorte de ghetto latin
où s'installent les ambassades chrétiennes (seul l’Empereur
germanique pourrait prétendre à l’égalité avec
le sultan et avait le privilège d'être logé à Constantinople).
Ici, on boit le vin à volonté dans les tavernes grecques. C’est
là aussi que se fait le commerce avec l’Occident. Les Levantins de
Galata sont des courtiers, les intermédiaires privilégiés
de l’Europe et Galata cesse d’être un ghetto pour devenir le cœur
économique de la ville. Au XIXe s. Galata aura sa rue des banques
en même temps que la première municipalité de l’empire.
Une
belle mixité sociale, culturelle et cultuelle qui s'est malheureusement
perdue au fil du XXe siècle...
Nous
plongeons dans le tourbillon de la place du secteur de Karaköy, un noeud
stratégique pour la circulation au débouché du pont et croisement
avec le second axe important de Galata, parallèle au rivage qui va de la
porte de l’Arsenal à la porte de Tophane (fonderie de canons). Autour
se dressent de grands immeubles cossus, souvent sièges de banques.
Pour notre part, nous partons à l'assaut de la colline en empruntant un
réseau de petites rues et des escaliers qui ne sont pas sans nous rappeler
ceux de la Butte de Montmartre.
![]()
![]() Enfin
nous débouchons sur la place où se dresse la Tour de Galata.
Enfin
nous débouchons sur la place où se dresse la Tour de Galata.
 | ||
L'antique
tour "Castellion ton Galatou" du VIe s. est l'une des plus anciennes
tours du monde.
Elle aurait été construite en bois pour servir
de phare sous le règne de l'empereur byzantin Anastase Oilozus en 527 après
J-C. Mais petit problème de chronologie car l'empereur Anastase Ier
selon d'autres sources serait mort en 518, son successeur Justin Ier serait
mort à son tour en 527 et en 528 c'est son fils adoptif, le célèbre
empereur Justinien Ier qui règne alors...
Quoi qu'il en soit,
les Génois rebâtirent une tour de maçonnerie en 1348, tour
rebaptisée "Tour du Christ". Après la conquête de
la ville en 1453 et ayant perdu ses deux derniers étages, les Ottomans
la transformèrent en prison et en tour de guet et elle fut restaurée
en 1510. En 1794 la partie supérieure fut reconstruite, renforcée
par des arcs de pierre et couverte d'un toit conique en bois recouvert de plaques
de plomb. C'était le plus haut édifice de la ville. La tour a été
restaurée entre 1964 et 1967.
Au XVIIe siècle (ou peut aussi
lire XVIIIe !), aurait eu lieu ici un exploit légendaire avec le premier
homme volant, Hezarfen Ahmet Çelebi, qui en s’élançant
de la tour de Galata avec des ailes qu’il avait fabriquées aurait
réussit à traverser le Bosphore pour atterrir sur une place à
Üsküdar, du côté asiatique. Le sultan Murat IV l'aurait
récompensé en le couvrant d’or puis, méfiant, exiler
à Alger. Scientifiquement, il semble que ce genre d'exploit soit impossible
même avec la technologie d'aujourd'hui.
Dans
les années 1960, la structure intérieure d'origine qui était
en bois fut remplacée par une structure en béton et équipée
de deux ascenseurs qui conduisent à l'avant-dernier niveau. Il en coûte
12YTL pour les emprunter.
La tour haute de 35 mètres, avec ses neuf
étages et son toit, culmine à près de 67 mètres au-dessus
de la mer (près de 52 m au niveau de la terrasse d'observation). La tour
a un diamètre d'environ 16,50 mètres à la base pour un diamètre
intérieur de 9 mètres de diamètre. Ses murs ont 3,75 mètres
d'épaisseur à la base.
Les étages supérieurs (septième
et huitième) percés de 14 fenêtres sont occupés par
un bar, un restaurant et une discothèque.
La visite vaut essentiellement
pour la vue à 360° sur la ville. Donc ne se justifie que par
beau temps clair. Vue sur le Bosphore et les gros "autobus de mer" de
la compagnie IDO (Istaubul Denis Otobüsleri), la Mer de Marmara, la Corne
d'Or, Topkapi, Sainte Sophie, la Mosquée Bleue, la Mosquée de Soliman...
 | ||
 | ||
Nous poursuivons vers le nord, vers le coeur du quartier de Péra.
En
1461, après sa défaite face au sultan Mehmed II, l'héritier
du trône de l'empire byzantin
dissident de Trébizonde
(en dissidence depuis 1204) fut exilé dans ce quartier de Péra d'où
son nom turc Beyoglu qui signifie "fils du bey".
   

| ||
![]() Peu
avant d'arriver au début de la rue Istiklal, station haute du funiculaire
de Tünel et point de départ du vieux tramway, nous passons dans une
rue bordée de boutiques d'instruments de musique traditionnels et modernes,
des magasins de disques puis devant l'ancien Monastère des Mevlevi
de la secte des Derviches Tourneurs, secte interdite par Atatürk en 1924,
devenu un musée de la poésie classique. C'est un quartier bohème.
Peu
avant d'arriver au début de la rue Istiklal, station haute du funiculaire
de Tünel et point de départ du vieux tramway, nous passons dans une
rue bordée de boutiques d'instruments de musique traditionnels et modernes,
des magasins de disques puis devant l'ancien Monastère des Mevlevi
de la secte des Derviches Tourneurs, secte interdite par Atatürk en 1924,
devenu un musée de la poésie classique. C'est un quartier bohème.
Depuis
les années 1950, on a assisté une “fuite” du centre de
Galata vers
Péra (Beyoglu), et ensuite au-delà de la place du Taksim.
C'est l'une des parties les plus importantes du centre historique d'Istanbul et
la plus vivante, cernée sur trois côtés par les quartiers
modernes.
Le quartier de Péra était au début du XXe s. la fierté de la ville. Ambassades, prestigieuses écoles, immeubles bourgeois, théâtres, cinémas, restaurants et tavernes, c’est ici que la bonne société stambouliote vivait et sortait, dans se qu'on voulait voir comme le “Paris oriental”. Mais la Révolution turque mit fin non seulement aux privilèges des étrangers et des minoritaires, mais aussi au rôle de capitale qu’exerçait Istanbul jusqu’en 1923 (les ambassades étant rabaissées au rôle de consulats).
Dans
les années 30 une première vague d’habitants quitta ce quartier
pour s’établir dans de nouvelles surfaces urbanisées au nord.
Puis les émeutes de septembre 1955 précipiteront le départ
en masse des Grecs suite au pogrom dont ils ont ffait l'objet à la suite
à une fausse rumeur selon laquelle des Grecs auraient détruit la
maison du père de la République, Atatürk, à Thessalonique.
Une partie des habitants a continué de partir vers les nouveaux quartiers
périphériques au cours des années 1960-70, favorisant le
délabrement du quartier. Cependant depuis les années 1990, un travail
de rénovation urbaine a été entrepris favorisant le classement
des immeubles tandis que l'ancienne Grand’Rue de Péra (Istiklal
Caddesi), sorte de "Champs-Elysées" stambouliotes, reliant
la place du Tünel à celle du Taksim a été transformée
en voie piétonne et n'y circule que l'ancien tramway (nostaljik tram).
Une population un peu mondaine se donne rendez-vous dans ce quartier "Années
Folles" et s'y mêlent lycéens, étudiants et touristes.![]()
![]()
![]() Sur la rue Istiklal, il
est bien agréable de déambuler au
milieu des badauds. De nombreux étals forains vendent des marrons ou plus
précisément de grosse châtaignes grillées (kestane,
c'est étonnant au printemps), d'autres des sucreries. Les immeubles plus
ou moins cossus, plus ou moins ravalés, abritent des banques, assurances
et société diverses mais aussi des boutiques: pharmacies (eczane),
salons de thé, marchands de fruits et légumes, de glaces et confiseurs
(loukoms, bakalavas...) et pâtissiers (énormes gâteaux colorés
et à la crème!)...
Sur la rue Istiklal, il
est bien agréable de déambuler au
milieu des badauds. De nombreux étals forains vendent des marrons ou plus
précisément de grosse châtaignes grillées (kestane,
c'est étonnant au printemps), d'autres des sucreries. Les immeubles plus
ou moins cossus, plus ou moins ravalés, abritent des banques, assurances
et société diverses mais aussi des boutiques: pharmacies (eczane),
salons de thé, marchands de fruits et légumes, de glaces et confiseurs
(loukoms, bakalavas...) et pâtissiers (énormes gâteaux colorés
et à la crème!)...
Après être passés devant le Consulat de Russie, nous prenons sur notre gauche une rue perpendiculaire (Orhan Adlin Apaydin) puis le rue Mesrutiyet ce qui nous permet de passer près du fameux hôtel Pera Palas qui date de 1896 et associé au mythe le L'Orient Express a reçu des hôtes de marque comme Agatha Christie, Greta Garbo, Joséphine Baker, Mata Hari ou Sarah Bernhardt... Puis c'est l'ancien Hôtel Bristol devenu Musée de Pera.
Nous revenons sur Istiklal. D'un côté nous jetons un oeil (extérieur) vers l'église catholique St Antoine de Padoue (kilise Aziz Antuan Padova) et, au fond d'une petite rue de l'autre côté, vers une église que nous ne saurons identifier.
Les
restaurants se densifient et nous arrivons au coeur du quartier, là où
la rue change de direction, le secteur de Galatasaray. Galatasaray se situe
au cœur du vieux Péra, à mi-distance de la place du Tünel
et de celle de Taksim. Ce quartier commerçant est habité par des
Stambouliotes d'origines arméno-catholique, grecque, musulmane et russe.
Dans ce lieu particulièrement animé passent chaque jour environ
1,2 million de personnes et le double les week-ends.
Ce secteur a été
reconstruit dans un style Art Nouveau à la suite d'un grand incendie survenu
en 1871, avec une demi-douzaine de passages urbains, à la mode de Paris.
Ce nom fait penser à la célèbre équipe de football.
Nous passons devant les grilles monumentales du lycée francophone de
Galatasaray, lycée réputé qui pendant des années
forma l'élite turque. Cet ancien lycée impérial fondé
en 1868 permet à quelque 1500 enfants de diplomates et de la bourgeoisie
de suivre toutes leurs études, du primaire à l’université,
en français.![]()
Petit
détour dans le réseau de ruelles et de passages constituant le Marché
de Galatasaray, dit marché aux poissons, très réputé
pour ses produits (poissons mais aussi viandes, fromages, pâtisseries...).
On peut s'attendre à ce qu'il soit couvert mais il n'en est rien depuis
sa rénovation réalisée en 2005-2006 a supprimé le
toit.
Coup d'oeil dans le Passage d’Europe (AvrupaPasaji)
aussi appelé Passage des Miroirs avec ses magasins d’antiquités
et ses bijouteries qui ont remplacé les merciers après la rénovation
d'après les années 1990. C'est l’un des plus beaux passages
dans le Marché aux Poissons (Balik Pazari), le marché coloré
du quartier. Il s’agit d’une copie du passage Choiseul à Paris.
Les chapiteaux corinthiens sont surmontés de 12 statues en bronze. Un pont
permet l’accès d’une galerie à l’autre, à
l’étage.
Quant au Passage de Péra ou des Fleurs
(Pera Pasaji ou Çiçek Pasaji), en forme de L, il fut
créé après l’incendie de Péra en 1871 (ou 1976?),
sur les ruines du Théâtre Naum (détruit par un ioncendie en
1870), par un architecte français (?) selon les uns et local (Kleanthis
Zannos ou Cleanthe Zanno) selon d'autres pour le compte du banquier grec Christaki
(ou Hristaki) Zografos... Il tire son nom du Café aux Fleurs qui se trouvait
à l'arrière du passage. Le marché aux fleurs qui s'y tenait
fut déplacé vers le Bazar Egyptien dans les années 1930.
A la suite d'un écroulement en 1982, deux étages furent supprimés.
Restauré dans les années 1980-90 à la faveur de l'essor touristique,
il regroupe maintenant des restaurants et cafés (meyhanes) chers
et racoleurs dans un somptueux décor. Trop cher. Dans la rotonde située
à l'articulation des deux allées du passage, on peut voir aux fenêtres
des étages des portraits photographiques eb noir et blanc, d'il y a un
siècle, en trompe-l'oeil...
Le Passage aux Fleurs débouche sur la Rue Sahne et le Marché aux
Poissons.
Tout près
de là, nous nous rabattrons sur la ruelle Nevizade Sokak,
où l'on trouve une vingtaine de meyhane, des restaurants qui proposent
les fameux mézzés. Dommage que dans notre prospection sur les menus affichés
sur la rue on subisse autant de racolage. Il faut faire semblant d’être
sourd.
![]()
Revenus sur Istiklal, nous passons devant le Consulat de France et nous ne tarderons pas à rejoindre la vaste place Taksim, l'ancien Champs de Mars, dont le centre est occupé par le Monument à la Gloire de la République (Cumhuriyet Aniti) du sculpteur italien Pietro Canonica (1928), et noeud important pour les transports en commun (métro, tramway nostalgique, funiculaire rejoignant le tramway à Besiktas). La place Taksim tire son nom du réservoir historique ottoman "maksem" (XVIIIe s.)
Le dernier jour de notre séjour, nous reviendrons dans ce quartier pour "un dîner copieusement arrosé" (!) dans un petit restaurant très bon marché, le Marmara Cafe, rue Büyük Parmakkapi (6 Katip Mustafa Çelebi Mh.).
Menu ISTANBUL