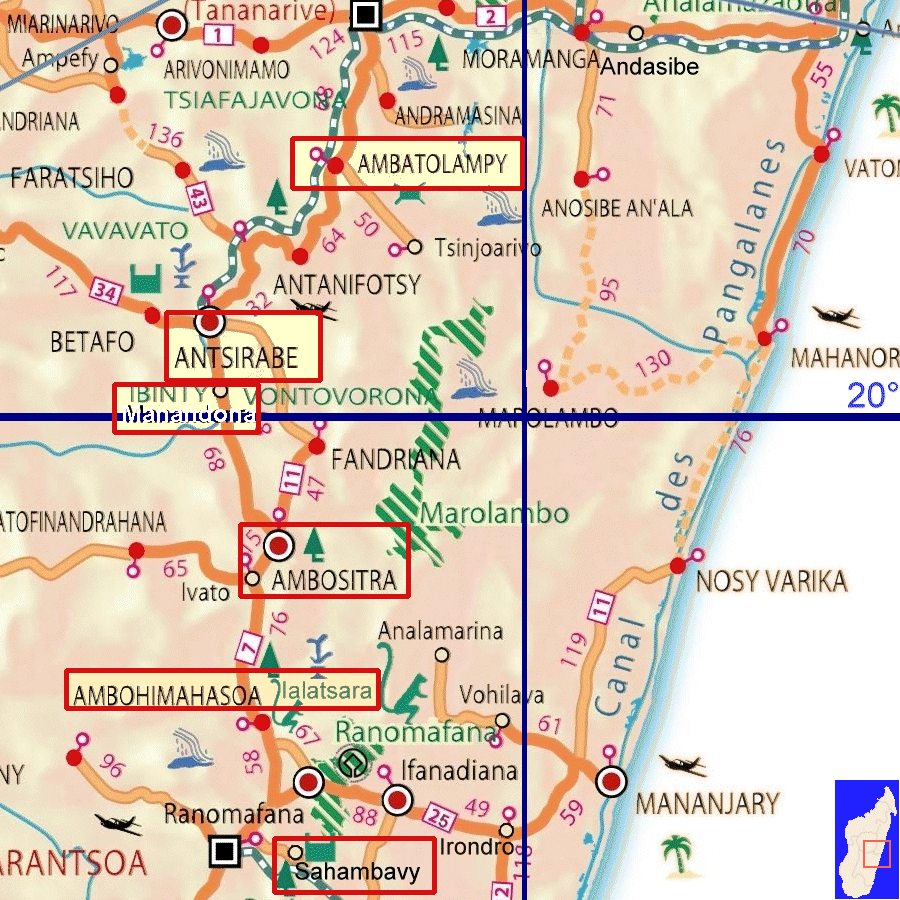
| ||||
| ||||||||||
|
Manao ahoana ! Bonjour !
![]() Debout à 7h30, après moins de 6 heures de sommeil.
Nous avons à peine eu le temps d'apprécier le confort de notre chambre
au Chalet
des Roses.
Debout à 7h30, après moins de 6 heures de sommeil.
Nous avons à peine eu le temps d'apprécier le confort de notre chambre
au Chalet
des Roses.
Petit-déjeuner continental
qui nous permet de faire connaissance avec les sachets de l'incontournable thé
malgache TAF...
A 9 heures nous avons rendez-vous avec Richard,
le responsable de notre agence pour un briefing d'avant circuit, régler le solde
de ses prestations et faire du change de monnaie et nous nous retrouvons avec
d'impressionnantes liasses de billets. Afin de ne pas
nous retarder, il commence à nous expliquer notre circuit sans attendre
une jeune stagiaire qui est en retard !
Pour
démarrer, ce n'est pas vraiment un rythme mora mora ("doucement,
lentement") que l'on prête traditionnellement aux Malgaches.
Peut-être
que les traditions se perdent car ce que l'on a pu percevoir de la vie des Malgaches
au cours de notre circuit, c'est qu'ils étaient loin d'être oisifs
et qu'ils s'affairaient souvent à des travaux pénibles. La notion
peut en revanche tout à fait s'appliquer aux transports collectifs...
Départ de Tananarive par la Nationale 7
![]() A10h, c'est parti avec Patrick au volant d'un 4x4 Mitsubishi Pajero. C'est
un véhicule de seconde main, importé du Japon comme en témoigne
le volant placé à droite. Confortable, avec climatisation dont nous
ne ferons pas usage car la température est agréable et lorsque nécessaire
on peut baisser facilement les vitres électriques, ce qui ma foi est bien
commode pour saisir quelques photos sur le vif.
A10h, c'est parti avec Patrick au volant d'un 4x4 Mitsubishi Pajero. C'est
un véhicule de seconde main, importé du Japon comme en témoigne
le volant placé à droite. Confortable, avec climatisation dont nous
ne ferons pas usage car la température est agréable et lorsque nécessaire
on peut baisser facilement les vitres électriques, ce qui ma foi est bien
commode pour saisir quelques photos sur le vif.
Nous avons environ 200 km
à parcourir pour cette première étape sur la fameuse Route
Nationale 7, sur la route de nos vacances françaises, non pas
vers la Côte d'Azur mais vers la côte sud-ouest de Madagascar !
Il faut commencer par remplir le réservoir. Dans la station Jovenna où
nous faisons le plein, je suis effaré par le prix des carburants:
le litre de gasoil à 2710 MGA (ou Ariarys) soit pratiquement 1 €uro,
le revenu journalier moyen d'un salarié malgache... La grande bouteille
d'eau achetée en boutique revient à un demi Euro (et un peu plus
du double dans les restaurants). Pas cher pour nous mais inabordable pour le Malgache
de base.
Nous découvrons les embarras de circulation dans
une ville qui a grandi trop vite, sans plan directeur et sans infrastructures
pensées pour l'automobile. Facteur aggravant le relief vallonné.
Facteur favorable: la pauvreté limite le nombre de véhicule et leur
taille. On dit que Madagascar est un "musée vivant de l'automobile
française" et c'est vrai. On y voit en quantité tout ce qui
a circulé chez nous depuis les années 1960-70 et notamment des quantités
de Renault 4 mieux connues sous le nom de 4L. Ceci n'empêche pas de
voir également leurs aînées 2CV Citroën. Ce qui est remarquable,
c'est le relatif bon aspect extérieur des véhicules. Ici, on a l'air
d'accorder de l'importance à l'apparence. Ce qui n'empêche de voir
souvent des capots levés et des mains dans le cambouis. Souvent ces véhicules
ont un petit quelque chose d'étrange dans leur allure... Après observation
plus attentive, on les trouve un peu "haut sur pattes" (suspensions
adaptées pour avoir un plus grand débattement sur les pistes), avec
en quelque sorte un petit air de famille avec les races de poulets haut sur pattes
que l'on voit sous les tropiques...
L'agglomération d'Antananarivo est très étendue, une bonne douzaine de kilomètres à partir du centre, pour la quitter en direction du sud. Plus on s'éloigne et plus les espaces de rizières viennent se mélanger aux zones d'habitat.
A 13 km au sud de la ville, nous passons près du Palais présidentiel d'Iavoloha sans le savoir car Patrick ne nous l'a pas indiqué. C'était le palais mégalomaniaque que se fit construire lors de son premier mandat Didier Ratsiraka, le quatrième président du pays (1976-1993).
Sur
la route, nous pouvons voir les premiers petits chariots astucieusement
bricolés que de jeunes Malgaches poussent et tirent pour transporter toutes
sortes de marchandises, du bois, du fourrage, des sacs de charbon de bois et des
sacs de riz qu'ils laissent dévaler dangereusement les côtes dès
que c'est possible. Ces engins improbables expriment la débrouillardise
de ces gens démunis: roues faites de rondelle de bois, de roulettes de
récupération et même de simples roulements à billes,
direction actionnée parfois par un volant récupéré
sur des voitures ou des camions, freins fait de patins de bois frottant sur les
roues...
Une spécialité malgache parmi d'autres...
La route est particulièrement dégradée car c'est un axe très emprunté. Aux nids de poule et aux accotements ravinés, il faut ajouter les rétrécissements à une seule voie pour le passage de nombreux ponts, les piétons aux abords des localités, les petits chariots, les véhicules en pannes, les taxis-brousse à l'arrêt à une halte....
![]() Premier arrêt, à 11H, aux environs
d'Ampangabe, pour voir un étal d'artisanat de vannerie en raphia
coloré et tressé, objets plus ou moins utilitaires du genre chapeau
(satroka), accessoire apprécié des Malgaches, ou jouets et
objets décoratifs. A l'arrière de l'étal, tout un clan de
plusieurs familles, avec leurs enfants car la rentrée n'a pas encore eu
lieu, s'affaire au travail sur le raphia ou aux feux qui chauffent les cocottes
où mijote le déjeuner. Cette cuisine au bois à l'inconvénient
de dégager beaucoup de fumée et les objets achetés en gardent
encore
l'odeur des mois après notre retour...
Premier arrêt, à 11H, aux environs
d'Ampangabe, pour voir un étal d'artisanat de vannerie en raphia
coloré et tressé, objets plus ou moins utilitaires du genre chapeau
(satroka), accessoire apprécié des Malgaches, ou jouets et
objets décoratifs. A l'arrière de l'étal, tout un clan de
plusieurs familles, avec leurs enfants car la rentrée n'a pas encore eu
lieu, s'affaire au travail sur le raphia ou aux feux qui chauffent les cocottes
où mijote le déjeuner. Cette cuisine au bois à l'inconvénient
de dégager beaucoup de fumée et les objets achetés en gardent
encore
l'odeur des mois après notre retour...
Les
lanières de raphia qui sont ainsi tissées ou tressées proviennent
d'un palmier de zone humide dont les feuilles peuvent atteindre 25 m de long,
un record ! Ce n'est pas pour rien que le nom désignant la fibre se
trouve être d'origine malgache puisque Madagascar a pratiquement le monopole
du raphia employé dans le monde.
Aux abords de la route, outre les rizières et les premiers fours
à briques en cours de cuisson si l'on en juge à la fumée
qui s'en dégage (du bois est intercalé dans la meule entre les briques
de terre crue) et d'autres sont en train de refroidir (il faut attendre trois
semaines), on peut observer déjà les méfaits de la déforestation
qui favorise le ravinement des collines à la saison des pluies. Ces cônes
de ravinement sont désignés avec un mot malgache, lavaka
(qui signifie "trou"), mot passé dans le langage international
des géomorphologues.
Contrastant avec le vert des rizières,
la couleur rouge de la latérite s'impose dans le paysage (d'où le
surnom "d'île rouge") et dans
les maisons faites en pisé ou en briques. Les
maisons de ce style, en brique et à étage, avec balcon supporté
par des colonnes de brique, sont apparues sous l'influence du fameux Jean Laborde,
conseiller de la Reine Ranavalona Ière
(première moitié du XIXe s).
Les plus anciennes sont couvertes de chaume tandis que le toit de certaines constructions
récentes est en tôle. Ces maisons récentes sont parfois recouvertes
par des enduits modernes faits avec un mortier à base de ciment et peint
de diverses couleurs. Seuls points communs, elles comportent un étage (parfois
deux pour les maisons récentes les plus cossues) et n'ont pas de cheminée
d'où des traces de fumée sur les façades, au-dessus des fenêtres.
Heureusement que Madagascar est une île peu affectée par la sismicité
car la plupart de ces maisons s'effondreraient comme de simples châteaux
de cartes.
Des églises multiples (protestante et catholique) dans le
moindre village et parfois au milieu de nulle part. Plus loin, un long étal
de grandes statues de la Vierge Marie occupe l'accotement.
Un petit air
landais ou périgourdin avec des publicités pour le foie gras de
canard. La technique de gavage a été expérimentée
au début des années 1960 et la filière s'est développée
vraiment à partir des années 1980 avec la société
Bongou. Certains programmes de voyage font une visite sur ce thème au petit
village de Behenjy.
Il
est bientôt midi lorsque nous arrivons à Ambatolampy après
avoir traversé des paysages à l'incroyable palette de couleurs.
AMBATOLAMPY
[ambatoulamp']
![]()
![]()
![]()
![]() Avant de déjeuner Patrick
souhaite nous faire visiter une fonderie de cocottes en aluminium avec la technique
de coulage "à moule perdu".
Avant de déjeuner Patrick
souhaite nous faire visiter une fonderie de cocottes en aluminium avec la technique
de coulage "à moule perdu".
Dans une impasse à la
chaussée en terre défoncée, première fabrique fermée
nous dit-on pour finalement se raviser et nous dire que se tient dans la cour
un "banquet-pique-nique" de fête de retournement de mort (Famadihana)
mais que des ouvriers travaillent quand même...
A cette heure de la
journée et avec tous les foyers disposés dans la cour pour fondre
de vieux morceaux d'alu (y compris des morceaux de blocs moteurs) à l'aide
de charbon de bois, il fait particulièrement chaud et enfumé. Mon
épouse frôle le malaise vagal et ne voit donc pas grand chose du
processus de fabrication.
Pourquoi
travailler l'alu et non pas la fonte ?
L'alu est l'un des métaux
qui fond à assez basse température, 660°, donc sa métallurgie
est abordable de façon artisanale (en recyclage du métal car sa
fabrication initiale à partir de la bauxite, un minerai pauvre, est complexe
-utilisation de produits chimiques- et coûteuse, particulièrement
en énergie électrique).
En recyclage, la fusion du métal
n'est donc pas trop difficile à obtenir. La partie la plus étonnante
de la fabrication concerne la réalisation du moule ou plutôt des
moules et le coulage proprement dit.
 | ||
Quatre
ouvriers s'affairent dans l'atelier en totale insécurité par rapport aux risques
de brûlure et d'inhalation de fumées et poussières, où l'on assiste à
quelque chose
de spectaculaire.
Les moules sont fait d'un sable très fin, de couleur
sombre, humidifié pour se tenir. Le moule intérieur correspond au
pâté de sable fait avec le contenu d'une cocotte-modèle retournée
sur un plateau. Ce moule est réutilisé et retouché si nécessaire.
Ce moule est recoiffé par la cocotte-modèle afin de confectionner
le moule extérieur qui est fait de deux cadres de bois qui sont remplis
de sable fortement tassé afin de pouvoir être retirés méticuleusement
afin de dégager la cocotte-modèle. Maintenant, ces moules extérieurs
viennent emboîter le premier moule. Pour que l'ensemble se maintienne bien
en place, outre des guides faits de tiges d'acier traversant les moules extérieurs,
deux ouvriers grimpent sur l'assemblage pendant la phase de coulage ! Dans
l'espace ménagé ainsi entre moule intérieur et moule extérieur
on coule l'aluminium fondu. On verse le contenu en fusion d'un creuset (une petite
poche de transport) dans un orifice de moule supérieur jusqu'à ce
que qu'un évent faisant office de trop-plein rejette le métal excédentaire.
Rapidement les ouvriers qui travaillent pieds nus procèdent au démontage
du moule, libèrent la nouvelle cocotte et le cycle de fabrication recommence.
Après refroidissement les cocottes brutes passent dans un atelier de finition où on ébarbe et où on lime les bavures de fonte, ce qui explique les petites particules de limaille brillante qui flottent dans l'air.
  | ||
![]() Tout
cela nous aura mis en appétit lorsque nous nous attablons pour déjeuner
une petite demi-heure plus tard "Au Rendez-Vous des Pêcheurs - depuis
1951 Restaurant Gastronomique". Il n'y a pas foule pourtant le service traîne
un peu. Mes accompagnatrices se laissent tenter par des plats à base de
porc ou de volaille. Pour ma part, j'attaque mon premier repas typiquement malgache,
un copieux "romazava de zébu aux brèdes mafana",
servi en cocotte alu comme il se doit !
Tout
cela nous aura mis en appétit lorsque nous nous attablons pour déjeuner
une petite demi-heure plus tard "Au Rendez-Vous des Pêcheurs - depuis
1951 Restaurant Gastronomique". Il n'y a pas foule pourtant le service traîne
un peu. Mes accompagnatrices se laissent tenter par des plats à base de
porc ou de volaille. Pour ma part, j'attaque mon premier repas typiquement malgache,
un copieux "romazava de zébu aux brèdes mafana",
servi en cocotte alu comme il se doit !
Décodage: le romazava
mafana, c'est une sorte de pot au feu dont les légumes sont uniquement
les feuilles de ces brèdes mafana (Acmella oleracea parfois appelée
"cresson de Pará" et originaire d'Amérique du sud), les
fleurs jaunes et les feuilles de brèdes mafanas ont un goût piquant
(mafana veut dire "chaud") et poivré très persistant
en bouche avec une sensation légèrement astringente, après
coup.
Coût du plat servi accompagné au choix de riz, pois chiches
ou rougail (sorte de ratatouille à base de tomates, oignons, gingembre,
citron, piment): 10 000 MGA soit 3,50€. La grande bouteille d'eau
(1,5 l) tout comme la grande bière THB de 65 cl. coûtent
3000 MGA.
On continue sur la Nationale 7
![]() Trois quarts d'heure plus tard, il faut songer à reprendre la route. Le
soleil est ardent et sa position septentrionale nous rappelle que nous sommes
dans l'hémisphère austral, ce qui nous surprend moins depuis notre
circuit péruvien.
Trois quarts d'heure plus tard, il faut songer à reprendre la route. Le
soleil est ardent et sa position septentrionale nous rappelle que nous sommes
dans l'hémisphère austral, ce qui nous surprend moins depuis notre
circuit péruvien.
En traversant la ville, c'est l'occasion de voir
les premiers pousse-pousse. Cette invention japonaise et non pas chinoise
qui s'est répandue à travers le monde depuis la fin du XIXe s.
a été particulièrement adoptée par les Malgaches,
toujours dans sa version d'origine, la traction humaine. La version modernisée
de type tricycle (ou cyclo-pousse) est peu représentée. On verra
ces "hommes chevaux" courant dans les rues de toutes les bourgades et
villes traversées le long de la Nationale 7. Et n'allez pas croire
que ce moyen de transport soit destiné aux touristes. Les Malgaches en font
usage pour se faire transporter, parfois à deux ou trois (une mère
et des enfants par exemple), ou pour le transport d'objets (madriers...), sacs
et colis.
Dans
la campagne, des maisons se font plus coquettes avec leur pisé peint
dans des pastels rosés. Nous commençons également à
remarquer les premiers tombeaux monumentaux érigés dans les
champs. Près d'une rivière, les lavandières étalent
le linge à sécher sur des rochers. Et plus loin, les troupeaux de
zébus se dirigeant vers les abattoirs de la capitale font étape
dans des pâturages.
Les fonds de vallées sont occupés
par des rizières ainsi que les premières pentes cultivées
en esthétiques terrasses, héritages des lointaines migrations
indonésiennes. Moins gracieusement, on aperçoit de temps à
autre les fumées de feux, brûlis (tavy) ou feux de forêt...
Puis ce sont des femmes occupées à casser des cailloux au bord de
la route (ça nous rappelle l'Inde ou la Birmanie). Des vendeurs de charbon
de bois ont installé de vraies barricades de sacs blancs au bord de la
route. Un moment nous longeons la voie ferrée allant d'Antsirabe à
Tamatave (Toamasina), en passant par la capitale.
En approchant d'Antsirabe,
surprise de voir un tuk-tuk Bajaj, la grande marque indienne pour ces engins.
Ne parlait-on pas de l'Inde à l'instant ? Un auto-rickshaw égaré ?
En fait, il faut savoir que Madagascar accueille une importante communauté
indo-pakistanaise qui "prospère" dans le commerce... Mais c'est
plutôt un flot de pousse-pousse que l'on va rencontrer ici car Antsirabe
a la réputation d'être "la capitale des pousse-pousse".
ANTSIRABE
("là où abonde le sel ") [antsirabé]
![]()
![]()
Antsirabe
est la troisième plus grande ville de Madagascar après Antananarivo
et Toamasina (ex-Tamatave),
avec une population qui pourrait être estimée à près
de 200 000 habitants. Cette ancienne capitale du Vakinankaratra est située
à 1450 m d’altitude.
La ville a été célèbre
à l'époque coloniale: "ville d'eaux de l'hémisphère
sud", à l'atmosphère rafraîchie par l'altitude (c'est
l'endroit le plus froid du pays) ce qui est apprécié à la
saison chaude. La ressource thermale est à mettre en rapport avec l'environnement
d'anciennes montagnes volcaniques. Cette activité a périclité
tandis que quelques activités industrielles ont pris la relève:
embouteillage de l'eau minérale gazeuse "Vasy Gasy" ,
brasserie de la fameuse bière THB (Three Horses Beer) et textile.
La production de fromage est aussi l’une des principales activités d’Antsirabe
(en concurrence avec les fromages d'Ambatolampy et d’Ambatomanga).
Antsirabe: atelier de
lapidaire
![]()
![]() Première visite d'artisanat au programme, un petit atelier de
travail de gemmes. Rien d'étonnant avec la grande variété
de pierres semi-précieuses que la Grande Ile recèle. Nous sommes
gentiment reçu par les lapidaires de la "Taillerie de la Ville
d'Eau Chez Joseph".
Première visite d'artisanat au programme, un petit atelier de
travail de gemmes. Rien d'étonnant avec la grande variété
de pierres semi-précieuses que la Grande Ile recèle. Nous sommes
gentiment reçu par les lapidaires de la "Taillerie de la Ville
d'Eau Chez Joseph".
Antsirabe: artisan confiseur
![]()
![]() Un peu plus tard, cette fois il s'agit d'un artisanat plus banal puisqu'il s'agit
d'un atelier de confiseur "Chez
Marcel" où nous passerons une petite demi-heure. L'atelier
ne paie pas de mine mais l'accueil est charmant. On nous fait une démonstration
complète de fabrication de bonbons en nous proposant de choisir deux parfums
naturels parmi une quinzaine. Nous optons pour citron et gingembre. Ça va piquer
un peu...
Un peu plus tard, cette fois il s'agit d'un artisanat plus banal puisqu'il s'agit
d'un atelier de confiseur "Chez
Marcel" où nous passerons une petite demi-heure. L'atelier
ne paie pas de mine mais l'accueil est charmant. On nous fait une démonstration
complète de fabrication de bonbons en nous proposant de choisir deux parfums
naturels parmi une quinzaine. Nous optons pour citron et gingembre. Ça va piquer
un peu...
Le sucre de canne est fondu dans une cocotte en alu pour en faire
un sirop épais. Pour le type de bonbons croquants que l'on va nous fabriquer,
il faut porter le sirop à environ 140°, au stade "cassé".
A la température requise le sirop est versé sur une sorte de paillasse,
une pierre de granit huilée. La poudre des ingrédients apportant
le parfum est ajoutée puis
la
pâte
est travaillée d'abord à la spatule puis lorsqu'elle a un peu refroidit
et commencé à se figer, elle est travaillée à la main
et étirée pour y incorporer de l'air. Le malaxage continue en étirant
le cordon de pâte sur une tige métallique. Après quoi, trois
formes sont données aux bonbons: découpage en biais avec des ciseaux
en forme de berlingots dits "bonbons à la française",
bonbons coupés au fil puis roulés en boule dits "bonbons malagasy"
et enfin technique plus sophistiquée, passage du cordon de pâte entre
les rouleaux d'une presse à bonbons qui y imprime des motifs après
quoi il est facile de séparer les bonbons d'autant qu'après refroidissement
leur matière est devenue cassante.
![]()
![]() La journée sera
riche en visites puisque quelques minutes plus tard nous nous retrouvons "Chez
les Six Frères", un atelier travaillant la corne de zébu.
La journée sera
riche en visites puisque quelques minutes plus tard nous nous retrouvons "Chez
les Six Frères", un atelier travaillant la corne de zébu.
Cette démonstration nous permet d'assister au travail d'ébauche d'un objet décoratif en forme d'oiseau stylisé. Là aussi nous passerons une petite demi-heure.
Les cornes récupérées
dans les abattoirs sont chauffées et à un moment donné, un
coup sec frappé sur la corne permet d'en détacher le cornet osseux
(le chauffage liquéfie les tissus entre os et kératine). A noter
que la couleur de la corne dépend de la couleur de la robe du zébu
duquel elle provient. Ensuite, c'est un travail plus artistique d'entaillage à
la scie, de chauffage pour assouplir la kératine afin de déformer
et tordre certaines parties, puis de polissage en passant successivement au touret,
à la lime, à la toile émeri, à la lame de verre en
guise de grattoir et, pour finir, lustrage avec de la cendre. La fabrication complète
de ce modèle d'oiseau demande trois heures de travail, un ouvrier en produit
donc trois par jour... Les déchets transformés en farine servent
d'engrais et d'aliment pour le bétail.
Côté boutique
on peut voir la grande variété d'objets que l'on peut faire avec
la corne. Objets utilitaires comme peignes ou chausse-pieds, verres, couverts,
coupe-papier... Objets de parures: pinces à cheveux, bracelets, colliers,
bagues, pendentifs, boucles d'oreilles... en couleurs naturelles ou teintés.
Objets décoratifs plus ou moins fantaisistes: coffrets à incrustations
de corne,
bateaux,
oiseaux, poissons, insectes monstrueux...
Pour être complet, il nous manquera la visite d'ateliers de broderie.
Antsirabe:
la ville en vitesse
![]() Il est déjà
16h30 et le tour de ville pour voir les bâtiments coloniaux sera donc vite
expédié. Après coup, j'ai constaté que nous avons
débouché sur l'avenue de l'Indépendance, avec derrière
nous l’Hôtel des Thermes que nous ne verrons
même pas. Remontant l'avenue, nous sommes passés
entre la Poste et la Stèle de l'Indépendance à la gloire
des 18 ethnies du pays ...sans que Patrick nous les signale le moindrement du
monde.
Il est déjà
16h30 et le tour de ville pour voir les bâtiments coloniaux sera donc vite
expédié. Après coup, j'ai constaté que nous avons
débouché sur l'avenue de l'Indépendance, avec derrière
nous l’Hôtel des Thermes que nous ne verrons
même pas. Remontant l'avenue, nous sommes passés
entre la Poste et la Stèle de l'Indépendance à la gloire
des 18 ethnies du pays ...sans que Patrick nous les signale le moindrement du
monde.
Photo rapide depuis la voiture en passant devant le bâtiment
à tour centrale de la gare construite en 1923 mais nous
n'aurons pas le loisir d'observer les maisons merina à colonnes, ni de
jeter un coup d'oeil à la cathédrale de la Salette ou de voir l'établissement
thermal construit en 1917 (qui d'après la doc a une architecture qui rappelle
celle de la gare).
Nous quittons la ville toujours au milieu d'une
dense circulation de pousse-pousse.
La région située aux alentours de la ville d’Antsirabe s'appelle le Vakinakaratra. Il est un peu plus de 17 heures quand nous arrivons dans la bourgade de Manandona, un village entouré de rizières. Le jour baisse, lorsque nous quittons la route pour prendre sur notre droite une piste qui traverse les rizières et qui bientôt, de plus en plus défoncée, grimpe sur un coteau.
A 17h15, sur notre
gauche, un grand tombeau familial derrière une bâtisse.
Nous
voici arrivés au terme de l'étape, notre gîte Bakobako,
chez Jean-Gustave et Honorine Rabary, à Ambohitrimanjato. Il se
situe vers les 1400 m. d'altitude, au pied de la montagne Ibity (2254 m.).
Le village compte 370 habitants dont la moitié d'enfants (environ 6 par
famille).
Bakobako,
c'est une onomatopée évoquant le roucoulement du pigeon malgache
( "coo-coo-ooooooooo") et c'est aussi un mot malgache signifiant
"gentils" lorsque l'on qualifie des jeunes enfants car on ne doit jamais
dire qu'ils sont beaux ou jolis. Tiens donc, voila un point commun avec l'Inde !
Quelques
mots sur nos hôtes
Ce
gîte et ses hôtes sont évoqués sur le site des voyageurs
Claudie
et Jacques. Si nous sommes d'accord avec eux sur le surnom de "vieux
coq" dont s'affuble lui-même le maître des lieux, en revanche
il y a un petit problème sur son prénom car il s'agit pas d'Eugène. Le personnage haut en couleur est débordant
de dynamisme malgré ses 78 ans. Il se fait aussi appeler Dada Bary (dada
signifie grand père et bary est un raccourci du nom de famille).
C'est un ancien technicien hydraulicien en charge de la gestion de l'irrigation
des rizières. Après l'indépendance en 1960, il a bénéficié
d'un séjour de 18 mois en Camargue pour se former.
On est bien accueilli
ici. Ce sera l'une des deux seules étapes du circuit où l'on nous
offrira un pot d'accueil: bière (une THB de 65 cl !) et cacahuètes.
Jean-Gustave est aussi un conteur et un animateur qui manie l'humour avec art.
En excellent français, il raconte sa vie et celle des membres de sa famille
en émaillant le tout d'anecdotes tandis que la nuit tombe vers 18 heures.
Notre conteur remonte même jusqu'à un grand-père qui eut rang
de gouverneur de la Reine ! Il parle de son épouse Honorine,
maîtresse cuisinière, spécialiste du zébu. Il évoque
aussi ses enfants, certains partis à la ville, et en particulier son fils
Jean Lamour dont il semble très fier et auquel il nous confiera demain
pour la ballade dans les villages et les rizières.
Personnage intéressant
et ...intéressé lorsqu'il nous montre sa "collection",
en fait un sac en plastique rempli de pièces de monnaies étrangères
auquel des euros font défaut comme il le déplore puis il embraye
sur sa "collection" de billets de banque en nous proposant un curieux
(é)change: un billet de 10 000 MGA contre un billet de 5€,
ce qui lui procurerait ainsi un gain de 4 000 MGA puisque le cours est
de 2 800 MGA pour un Euro !
 | ||
 Nos habituels voyages organisés en groupe
ont pu nous amener à loger dans des hôtels peu confortables mais
nous ne sommes ni des routards ni des trekkeurs et nous ne nous attendions pas
à la grande rusticité du gîte et à son confort
monacal (je
serais tenté d'écrire son inconfort),
surtout que notre première nuit malgache avait été fort écourtée.
Cela n'en reste pas moins une expérience intéressante mais, heureusement,
limitée...
Nos habituels voyages organisés en groupe
ont pu nous amener à loger dans des hôtels peu confortables mais
nous ne sommes ni des routards ni des trekkeurs et nous ne nous attendions pas
à la grande rusticité du gîte et à son confort
monacal (je
serais tenté d'écrire son inconfort),
surtout que notre première nuit malgache avait été fort écourtée.
Cela n'en reste pas moins une expérience intéressante mais, heureusement,
limitée...
Le gîte se présente sous forme d'une grande
maison à étage dont le rez-de-chaussée est précédé
par une galerie-terrasse. A chaque niveau, on trouve deux chambres lesquelles
comportent deux lits superposés soit 4 personnes. La maison comporte donc
16 couchages. Dans une maison voisine, il y a également deux chambrées
à 4 couchages. Jean-Gustave peut donc accueillir jusqu'à 32 personnes...
Ailleurs sur le
site du gîte on trouve mention de 52 lits (!).
Ce soir nous
ne sommes que trois pensionnaires alors que le gîte doit être au complet
le soir suivant.
En fait dans le cadre des actions de développement
s'appuyant sur le tourisme, il existerait également quatre autres gîtes
aux environs.
L'installation électrique est des plus sommaire
(câbles et dominos apparents) et l'éclairage n'est assuré que pendant
environ deux heures grâce à un groupe électrogène faiblard.
Avec un bat-flanc et un matelas plutôt mince, le couchage est dur. La protection
antimoustique se limite à des spirales à brûler qui, en raison
de l'humidité, refusent de brûler.
Un mot sur les sanitaires.
Il n'y en a évidemment pas dans le gîte. Des petits cabanons non
loin de là dans le jardin en font office. L'eau ne coule pas de
robinets ni de chasse d'eau. Des seaux d'eau froide et même chaude, à
la demande, sont mis à disposition. Vase de nuit également disponible...
sur demande.
La salle de restaurant ou plutôt le réfectoire
se trouve dans un petit bâtiment face au gîte.
![]() Avant le dîner, entre 19h et
19h30, Jean-Gustave nous a concocté un petit spectacle sans prétention,
autour d'un feu de camp, pour lequel il mobilise une demi-douzaine de
jeunes gens pour faire l'orchestre et une quinzaine d'enfants, dont certains de
ses petits-enfants. Les instruments relèvent de l'inventivité malgache:
guitares à cordes faites avec des câbles de freins de vélo,
banjo à cordes en fil de pêche... et plus traditionnels aponga,
tambours en peau de zébu. Dans la traditions malgache, danses et chants
empruntent parfois à l'actualité: "danse de la reine",
"danse des kalaks" (les Kalachnikovs utilisées par les
dahalos,
les voleurs de zébus"),
"danse exotique"...
Avant le dîner, entre 19h et
19h30, Jean-Gustave nous a concocté un petit spectacle sans prétention,
autour d'un feu de camp, pour lequel il mobilise une demi-douzaine de
jeunes gens pour faire l'orchestre et une quinzaine d'enfants, dont certains de
ses petits-enfants. Les instruments relèvent de l'inventivité malgache:
guitares à cordes faites avec des câbles de freins de vélo,
banjo à cordes en fil de pêche... et plus traditionnels aponga,
tambours en peau de zébu. Dans la traditions malgache, danses et chants
empruntent parfois à l'actualité: "danse de la reine",
"danse des kalaks" (les Kalachnikovs utilisées par les
dahalos,
les voleurs de zébus"),
"danse exotique"...
Quête pour les musiciens tandis que les
enfants espèrent des sacs de bonbons. Comme nous avons le souci de préserver
leur dentition, nous n'avons rien de tel à leur proposer. Nous remettons
un peu d'argent à Jean-Gustave contre la promesse qu'une partie sera transformée
en cahiers et crayons.
![]() A table !
A table !
Honorine n'a
pas failli à sa réputation de cuisinière pour le dîner.
Une surprise la légèreté de la vaisselle que nous aurions
pu prendre pour de la faïence. En réalité il s'agit de fine
tôle émaillée et décorée, que Jean-Gustave qualifie
de "vaisselle de le Reine" puisqu'il s'agit d'une technique héritée
de Jean Laborde, le conseiller de la
Reine Ranavalona I
![]() A 7heures, petit-déjeuner
tout aussi copieux que le dîner de la veille. Confiture maison, fromages
et miel aux goûts particuliers, thé, café, chocolat au lait
(à base de lait concentré Socolait). Également des galettes à
pâte blanche faites à base d'une farine grossière de riz,
des sortes de pancakes sans oeuf. Et aussi du "pain français",
en fait il s'agit d'un pain blanc trop pétri, à mie très
légère, comme on en trouvait chez nous il y a une trentaine d'années.
Au cours de notre voyage, nous retrouverons pratiquement partout cette même
texture de pain.
A 7heures, petit-déjeuner
tout aussi copieux que le dîner de la veille. Confiture maison, fromages
et miel aux goûts particuliers, thé, café, chocolat au lait
(à base de lait concentré Socolait). Également des galettes à
pâte blanche faites à base d'une farine grossière de riz,
des sortes de pancakes sans oeuf. Et aussi du "pain français",
en fait il s'agit d'un pain blanc trop pétri, à mie très
légère, comme on en trouvait chez nous il y a une trentaine d'années.
Au cours de notre voyage, nous retrouverons pratiquement partout cette même
texture de pain.
Balade dans les rizières et les villages
Ainsi réconfortés, notre petit groupe de vazahas (prononcer [vaza]) peut aborder la matinée de découverte des villages et rizières de la plaine en compagnie de Jean Lamour, le fils de Jean-Gustave. Outre son activité de guide et son implication dans une association de développement local, il exerce le métier d'architecte-ingénieur et il dirige des projets de construction y compris à Tananarive.
| La
notion de vazaha est un moyen de catégoriser l'étranger
par l'apparence physique, celui venu d'ailleurs, sans notion péjorative
ou raciste. Le terme peut aussi être appliqué à un Malgache
qui a vécu longtemps hors du pays. Enfin, il peut en être fait usage
pour désigner une personne au statut social élevé, comme
on dirait "patron". Mais a contrario, d'un expatrié bien acculturé,
on dira qu'il n'est plus vazaha ou alors que c'est un "vazaha gasy"
(étranger malgache). D'autres
désignations ethniques s'appliquent aux étrangers (ils n'ont pas
la nationalité malgache) notamment ceux venant d'Asie: Karana pour
les Indo-pakistanais et Sinoa pour les Chinois. Les Karanas tiennent une
grande part du commerce et les Malgaches ne les apprécient guère
(pogrom de 1987). |

![]() A 7h45, avec nos chaussures de
marche aux pieds, nous quittons le gîte avec un sac léger (il faut
quand même compter 1,5 litre d'eau par personne) et sans même porter
notre pique-nique. Nous allons parcourir environ 8 km en 4 heures de marche
très tranquille, à portée
de tout "petit marcheur".
A 7h45, avec nos chaussures de
marche aux pieds, nous quittons le gîte avec un sac léger (il faut
quand même compter 1,5 litre d'eau par personne) et sans même porter
notre pique-nique. Nous allons parcourir environ 8 km en 4 heures de marche
très tranquille, à portée
de tout "petit marcheur".
Un coup d'oeil dans le hameau voisin avec ses maisons élémentaires,
plus ou moins anciennes et plus ou
moins vastes, en pisé, en brique, à toit de chaume, à toit
de tôle, à terrasse couverte... Les enfants sont adorables, souriants
et polis et apparemment en excellente santé. Près du hameau, on
peut voir une sorte de fumière où les déchets ménagers
et animaux sont mis en compost, un lieu qui ne déplaît pas à
une poule venue picorer accompagnée de sa couvée et à un
porcelet tacheté qui vient y fouiner.
Un peu plus loin, nous voyons
quelques jeunes gens et des garçons affairés à la fabrication
de briques crues: pétrissage et moulage, briques mises à sécher
au soleil avant de rejoindre les murs de la maison voisine en construction. Puis
nous passons devant l'école primaire à 4 cours: CE1-CE2 et
CM1-CM2 avec des dessins et maximes peints sur les murs ("Nettoyer, c'est
bien", "Ne pas salir, c'est mieux"...). Le monument voisin érigé
en 1998 commémore le quatre-vingt-cinquième anniversaire de sa création
("R. M. 1913-1998 85 taona...").
 | ||
Puis
nous continuons à descendre vers la plaine en accompagnant un bout
de chemin deux enfants conduisant trois zébus au pâturage. Maintenant
nous allons marcher sur les chemins de terre des hameaux, le long des canaux d'irrigation
et parfois sur les diguettes séparant les parcelles. Nous rencontrons Honorine
qui s'en va faire des courses à vélo.
On découvre les
rizières. Aucune mécanisation et pratiquement aucun recours
à la traction animale (nous ne verrons qu'un attelage qui, semble-t-il,
ne procédait qu'à l'ameublissement d'une terre déjà
retournée) pour le travail de la terre. Les seuls zébus que l'on
voit sont gardés en pâturage sur de petites parcelles portant encore
d'anciens chaumes ou sur les digues. En effet, certaines parcelles ne sont pas
encore retournées, d'autres sont en cours de labour à l'aide de
bêches à long fer légèrement arrondi. Ces outils sont
utilisés de façon curieuse, on enfonce le fer non pas en s'aidant
du pied mais en précipitant le fer de toute sa force appliquée sur
le manche. Pour les jeunes filles à marier, plus le fer de la bêche
est long, plus celui qui la porte est un parti enviable. Autre curiosité,
l'ouvrier se place sur la partie retournée et attire la motte vers lui.
Dans certaines parcelles, on peut voir le vert très tendre des semis de
riz dont les plans commencent à être repiqués ailleurs dans
la boue par les femmes. Notre guide nous explique que l'on fait deux récoltes
par an dans cette région. Voyant que certaines parcelles sont transformées
en "carrière" pour en extraire la terre non loin de four à
briques, Jean-Lamour indique que c'est un moyen de pallier la baisse de production
qui se manifeste au bout de quelques années, il est bon d'extraire la terre
usée pour en faire des briques et retrouver un sol neuf.
On ne cultive
pas seulement le riz comme on peut le constater: manioc (qui se bouture simplement
avec des bout de tiges), taro ou "oreille d'éléphant"
(Colocasia esculenta), patate douce, papaye, pomme de terre, petits pois,
tomates, orge, armoise (Artemisia)... De cette plante (à ne pas
confondre avec l'ambroisie, sa cousine allergisante) à fleurs jaunes d'origine
chinoise dont on extrait une substance médicamenteuse, l'artémisinine pour
soigner les malades atteints de paludisme. Depuis 2006, la société
Bionexx a développé la culture sur quelques centaines d'hectares
à Madagascar mais il semble que cette culture soit de moins en moins rentable
pour les producteurs.
Autres cultures, cette fois dans les potagers, celles
de différentes variétés de brèdes (divers légumes
à feuilles comestibles).
Les paysans les plus pauvres exploitent moins
d'un hectare et doivent trouver un complément de revenu en travaillant
comme journaliers dans des fermes plus importantes, dont la surface peut atteindre
la trentaine d'hectares. Ce qui se traduit dans la taille et l'apparence des fermes
mais étant précisé que le summum de richesse se manifeste
dans les maisons colorées de fonctionnaires ! On voit même une
vieille Renault posée là au bord d'un sentier, aussi déplacée
que s'il s'agissait d'un OVNI !
Nous visitons d'ailleurs une modeste
maison dont l'unique pièce du rez-de-chaussée sert de cuisine
et salle à manger. Le noircissement du plafond et du haut de murs résulte
de l'absence de cheminée. Heureusement, comme on le constate, à
la saison sèche, on fait souvent la cuisine à l'extérieur.
Une échelle permet d'accéder à la chambre collective des
membres de la famille.
Dans une ferme plus riche, nous arrivons lorsque la
maîtresse de maison est en train de vanner le riz. Dans une cour voisine,
des tubercules de manioc sèchent au soleil.
Nous croisons des troupeaux
de zébus et aussi des villageois et de nombreux enfants, toujours courtois
et ne sommes jamais importunés. Cette règle du jeu que l'association
pour le développement a définie est bien intégrée
par les habitants en contrepartie des avantages collectifs que leur apportent
les retombées du tourisme.
Près d'un
hameau, un panneau en bois est disponible pour affichage libre, une sorte
de dazibao à la malgache. On peut y lire des messages en français
ou en malgache, écrits à la craie ou au charbon : "La fille
de M... est très jolie", "Je t'aime. Au revoir", "Mauvaise
habitude de vazaha ...paresseux".
Plus loin nous arrivons devant
une cabane en planche dont la façade ouverte sert de comptoir à
une épicerie de campagne devant laquelle la foule se presse tandis que
des lavandières sont à l'oeuvre dans le canal principal où
barbotent les canards et où les zébus viennent aussi s'abreuver
(et s'ils ne faisaient que cela !).
Des maisons en construction:
l'une que l'on commence à couvrir de chaume et l'autre dont les dernières
briques des pignons sont en cours de pose tandis que le drapeau malgache qui la
surmonte témoigne de son achèvement imminent... et toujours pas de
cheminée. Un bon moment plus
tard, nous passons près d'une carrière où des hommes tirent
des moellons de granit avec l'outillage le plus rudimentaire.
Nous arrivons au pied de la cascade de la source sacrée, surmontée d'un petit barrage permettant de dériver une partie de l'eau vers le canal d'irrigation. C'est l'une des seules occasions où l'on nous parlera de fady, de tabou. Ici il est interdit de se baigner dans la rivière. Par contre rien n'interdit au jeune couple d'amoureux que nous apercevons de franchir le barrage en quête de quelque coin tranquille !
 | ||
Un peu plus
loin on voit des femmes remontant péniblement des rizières où
un four à brique est installé en transportant sur leur tête
des paniers contenant au moins une douzaine de briques (15 kg probablement),
sous un soleil déjà ardent, il est 10h30. Arrivées sur le
sentier aux abords d'un hameau, le relais est pris par des fillettes qui emportent
de la même façon la moitié de la charge.
Maintenant nous
rentrons carrément dans les rizières, nous dirigeant vers le centre
de la plaine. Sur les diguettes on aperçoit des aigrettes (ou pique-boeufs
ou encore garde-boeufs) venues compléter leur repas d'insectes par quelques
grenouilles ou crustacés (écrevisses)...
Bien entendu,
Jean Lamour est connu de tous et semble respecté comme un notable,
qu'il n'est pas ! car il se refuse à se présenter aux élections
locales. En revanche, il a un rôle d'éducateur, discutant ici avec
une femme atteinte d'une tumeur au cerveau qui a besoin de médicaments,
là avec un adolescent qui travaille dans une rizière et qu'il soutient
dans ses études de fin de lycée pour l'orienter par la suite vers
l'Université...
|
A
l'époque des royautés, seuls les nobles érigeaient des Vatolahy
ou "pierres mâles" (forme phallique). |
Un
autre hameau, d'autres maisons, d'autres villageois... Une pierre levée
au bord d'un chemin. Ce mégalithe qui dépasse du sol sur environ
1,50m. n'est pas une borne mais un vatolahy, une stèle ou
"pierre royale" ou "pierre mâle" (forme
phallique) commémorant le passage ici d'un roi mérina il y a trois
siècles.
Plus loin, un avis (filazana) en langue malgache
(NB: en malgache, la structure générale de la phrase simple est
de type VOS "verbe - objet - sujet")
invite à inscrire les élèves en vue de la rentrée
prochaine, le 5 octobre (comme nous ! qui rentrerons en France ce jour là).
![]()
![]() Nous terminons notre visite par un petit atelier de tissage et d'élevage
de vers à soie de Clarisse et Haingo. Outre la soie d'élevage
issue des larves de Bombyx élevées dans des paniers remplis de feuilles
de mûrier, on y travaille aussi la soie sauvage achetée aux paysans
et dont on fait des écharpes...
Nous terminons notre visite par un petit atelier de tissage et d'élevage
de vers à soie de Clarisse et Haingo. Outre la soie d'élevage
issue des larves de Bombyx élevées dans des paniers remplis de feuilles
de mûrier, on y travaille aussi la soie sauvage achetée aux paysans
et dont on fait des écharpes...
![]() Il est bientôt midi
et tout cela nous a ouvert l'appétit. Nous allons pique-niquer sous
un petit préau de l'école primaire d'Ambohiponana.
Environ 350 élèves y sont accueillis dans 8 classes. Dommage que
la rentrée ne soit pas encore effectuée car il aurait été
certainement intéressant de visiter cette école en activité.
L'établissement qui bénéficie de financements d'ONG a l'air
important mais reste rustique... nous en utilisons les "cabinets" en
toilettes sèches se présentant sous la forme d'une batterie de cabanes
en planches, plus ou moins branlantes et pourries. On se demande comment les plus
jeunes enfants ne passent pas au travers des trous...
Il est bientôt midi
et tout cela nous a ouvert l'appétit. Nous allons pique-niquer sous
un petit préau de l'école primaire d'Ambohiponana.
Environ 350 élèves y sont accueillis dans 8 classes. Dommage que
la rentrée ne soit pas encore effectuée car il aurait été
certainement intéressant de visiter cette école en activité.
L'établissement qui bénéficie de financements d'ONG a l'air
important mais reste rustique... nous en utilisons les "cabinets" en
toilettes sèches se présentant sous la forme d'une batterie de cabanes
en planches, plus ou moins branlantes et pourries. On se demande comment les plus
jeunes enfants ne passent pas au travers des trous...
Jean Lamour a apporté
le pique-nique pour tout le monde dans son sac: copieuse salade végétarienne
à base de plusieurs légumes et d'oeuf dur émietté.
Pour finir, une orange en dessert.
Après ce repas, nous
retrouvons Patrick et son 4x4 à la sortie du hameau tandis qu'un attroupement
d'enfants se forme autour des vazahas en train de changer de chaussures.
Au revoir Jean Lamour et bon vent pour tes projets.
Nous avons
passé une agréable et instructive matinée en ta compagnie.
Nous avons vu tellement de choses mais pas le Palais
Royal indiqué au programme !
![]() Sur la piste conduisant à la Route Nationale 7 nous croisons Jean-Gustave,
alerte comme une jeune homme, qui rentre à pied du village principal.
Sur la piste conduisant à la Route Nationale 7 nous croisons Jean-Gustave,
alerte comme une jeune homme, qui rentre à pied du village principal.
Nous retrouvons le paysage de collines chauves par l'effet des feux de brousse
et feux en forêt (charbonnières) que l'on aperçoit souvent
et avec pour corollaire des marchands de sacs de charbon de bois installés
au bord de la route.
![]()
Après une
soixantaine de kilomètres avec le cadre des montagnes de l'Ankaratra, nous
avons quitté le pays mérina pour celui des Betsileo, plus précisément
des Zafimaniry, un sous-groupe des Betsileos, et nous arrivons à Ambositra.
![]()
![]() Un peu avant l'agglomération, sur le bord droit de la route, Patrick fait
un arrêt à l'atelier de marqueterie et sculpture zafimaniry
sur bois précieux (bois de rose, acajou, palissandre...) "Arts
Malagasy - Jean et Frère". Ce n'est pas notre jour de chance car
une bonne partie du personnel (le tiers ou la moitié !) se trouve
absent ce jeudi, pour des causes qu'on ne sait pas trop bien nous préciser:
fête de retournement de mort (famadihana)... Toujours est-il que
nous ne verrons que des sculpteurs au travail, ce qui est commun, mais ne verrons
aucun travail de marqueterie (technique de découpage notamment), beaucoup
plus passionnant selon les témoignages que j'ai recueilli auprès d'autres
voyageurs.
Un peu avant l'agglomération, sur le bord droit de la route, Patrick fait
un arrêt à l'atelier de marqueterie et sculpture zafimaniry
sur bois précieux (bois de rose, acajou, palissandre...) "Arts
Malagasy - Jean et Frère". Ce n'est pas notre jour de chance car
une bonne partie du personnel (le tiers ou la moitié !) se trouve
absent ce jeudi, pour des causes qu'on ne sait pas trop bien nous préciser:
fête de retournement de mort (famadihana)... Toujours est-il que
nous ne verrons que des sculpteurs au travail, ce qui est commun, mais ne verrons
aucun travail de marqueterie (technique de découpage notamment), beaucoup
plus passionnant selon les témoignages que j'ai recueilli auprès d'autres
voyageurs.
Le
savoir-faire du travail du bois des Zafimaniry a fait l'objet du classement de
la culture zafimaniry, proclamée par l'UNESCO![]() chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité
en 2003 puis inscrite en 2008 sur la liste patrimoine culturel immatériel
de l’humanité.
chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité
en 2003 puis inscrite en 2008 sur la liste patrimoine culturel immatériel
de l’humanité.
Il faudrait se rendre dans les villages de montagne autour du Mont Vohibe pour
vraiment l'apprécier dans sa forme authentique (portes et fenêtres
sculptées de motifs géométriques) de maisons en bois construites
sans tenons ni mortaises et donc sans chevilles (et évidemment sans clous).
     | ||
![]() Nous traversons Ambositra sans visiter le quartier de Tompon'I
Vinany, ni l'église des Jésuites, ni le Palais Royal
(encore un de raté!) mais il vrai que l'heure tourne. Il est près
de 15 heures et nous avons encore 85 kilomètres à parcourir soit
environ deux heures de trajet si l'on adopte cette mesure des distances plus appropriée
ici. Et toujours des fumées de feux, brûlis (tavy) ou feux de forêt. Les
maisons en pisé se font plus nombreuses.
Nous traversons Ambositra sans visiter le quartier de Tompon'I
Vinany, ni l'église des Jésuites, ni le Palais Royal
(encore un de raté!) mais il vrai que l'heure tourne. Il est près
de 15 heures et nous avons encore 85 kilomètres à parcourir soit
environ deux heures de trajet si l'on adopte cette mesure des distances plus appropriée
ici. Et toujours des fumées de feux, brûlis (tavy) ou feux de forêt. Les
maisons en pisé se font plus nombreuses.
Les défaillances mécaniques
et la fatigue aidant sont causes d'accidents. C'est sans doute ce qui est arrivé
au camion que nous voyons renversé sur le côté de la route.
Nous passons très
près de feux de brousses qui sont comme toujours hors de contrôle.
Notre chauffeur à demi rassuré
nous indique qu'à partir de maintenant nous entrons dans une des "zones
rouges" pour les attaques par les bandits, les dahalos,
voleurs de zébus et détrousseurs
de voyageurs.
Il ajoute qu'il vaut mieux ne plus être sur la route à la nuit venue...
Pour limiter les risques, et de panne, et d'embuscade, les taxis-brousse qui roulent
la nuit se déplacent en convois de 5 ou 6 véhicules.
     | ||
La panne !
![]() 16h20,
c'est la panne ! Ça n'arrive pas qu'aux taxis-brousse.
16h20,
c'est la panne ! Ça n'arrive pas qu'aux taxis-brousse.
Même
si nous ne sommes qu'à environ trois kilomètres de notre destination.
C''est ennuyeux. Il y a là nos affaires à transporter et comment
les choses vont-elles se passer pour la suite du circuit ?
Patrick est
catastrophé. Il a la responsabilité de nous acheminer. Le véhicule
appartient à son patron, Richard. Et il a clairement en vue qu'il va perdre
les 6 jours suivants où il devait nous accompagner jusqu'à Ifaty.
Apparemment aucun témoin n'a alerté sur un problème et c'est
la vapeur s'échappant du capot qui révèle un gros problème
de joint de culasse ou même, selon les dires de Patrick, de fissure de culasse.
Après dix minutes, le moteur ayant un peu refroidi, il met dans le radiateur
ce qui nous reste d'eau et, pour compléter, demande à des villageois
passant par là d'aller nous chercher de l'eau au ruisseau qui coule en
contrebas avec nos bouteilles vides. Ceux-ci s'acquittent bien de la commande
et reçoive de petits billets en échange de l'eau trouble rapportée.
Avec ce dépannage de fortune, nous arrivons à destination un
peu avant la nuit, vers 16h45.
L'Ecolodge
de l'Ialatsara ou "Lemur
Forest Camp" se trouve en bordure de route, sur la gauche, quatre
kilomètres avant d'arriver à la ville d'Ambohimahasoa.
Ouvert
en 2002, il est tenu par Daniel Rajaona,
un grand malgache métissé (mais ne le sont-ils pas tous, plus ou
moins ?) d'apparence bourrue mais fort sympathique qui vit ici pendant la
belle saison avec Bérénice, une Française. C'est d'ici que
demain la matinée nous devons partir à la découverte de la
Réserve privée de l'IADE (IAlatsara
Développement Ecoutourisme).
L'Ecolodge
![]() Une autre expérience intéressante
en matière d'hébergement.
Une autre expérience intéressante
en matière d'hébergement.
Nous aurons encore une nuit rustique
car nous logeons dans des bungalows légers sur pilotis, non totalement
clos (pointes de pignons non fermée). Eau pour la (et les) toilette(s)
à disposition dans des seaux, y compris l'eau chaude livrée sur
demande. Moustiquaire bien pratique au-dessus du lit mais cette fois-ci pas du
tout d'électricité. Il faut mettre les batteries de nos appareils
électroniques à charger dans la salle de restaurant. On peut s'éclairer
à la bougie posée sur le chevet mais ça ne me semble pas
judicieux avec la proximité des voilages des moustiquaires et dans un tel
bâtiment tout en bois. Il vaut mieux utiliser une lampe électrique
si on n'a pas oublié de s'en munir.
Le camp se trouvant au milieu
des bois, nous allons entendre des bruits divers de branchages, d'animaux.
D'ailleurs Daniel nous a dit de prendre la précaution d'accrocher à
un clou de la salle de restaurant ce que nous pourrions avoir de comestible avec
nous, bananes, bonbons... car cela pourrait amener des animaux à s'introduire
dans les bungalows, notamment les lémurs à ventre roux (Eulemur
Rubriventer).
Les 14 bungalows, dont trois dotés de toilettes intérieures
(nous en bénéficions), peuvent accueillir 20 pensionnaires mais nous
ne serons que cinq ce soir, nous trois et un jeune couple d'Alsaciens en voyage
de noces.
Nous voyons Patrick aller et venir, suspendu à son portable
et faisant grise mine. Il semble que Richard ne tienne pas à faire réparer
par ici et il lui faut donc trouver une solution pour ramener le 4x4 à
Tana. Quant à Patrick, il devra rentrer en empruntant les traditionnels
moyens de transport du pays...
Balade
nocturne dans la forêt: les premiers lémuriens et les plus minuscules

![]() En attendant le dîner, entre 18 heures et 18 heures 45, on nous propose
de faire une
brève visite nocturne dans les parages du camp sous la conduite
de Jean-Baptiste. C'est une option un
peu chère: 70 000 MGA. Cela nous permet de faire connaissance
avec Jean-Baptiste qui nous guidera la matinée suivante (et qui a guidé
cet après-midi les Alsaciens).
En attendant le dîner, entre 18 heures et 18 heures 45, on nous propose
de faire une
brève visite nocturne dans les parages du camp sous la conduite
de Jean-Baptiste. C'est une option un
peu chère: 70 000 MGA. Cela nous permet de faire connaissance
avec Jean-Baptiste qui nous guidera la matinée suivante (et qui a guidé
cet après-midi les Alsaciens).
![]() Munis de lampes de poche (les frontales c'est mieux), nous aurons l'occasion d'y
voir nos premiers lémuriens, les plus petits de tous les primates,
une espèce de grosse souris aux grands yeux en raison de son mode de vie
nocturne, le microcèbe roux (Microcebus Rufus). Moins de
15 cm pour le corps et moins de 30 cm avec la queue et un poids moyen d'environ
50 grammes. Il y a un peu de tricherie pour les observer facilement. En écrasant
un peu de banane, on répond à leur régime alimentaire omnivore.
Munis de lampes de poche (les frontales c'est mieux), nous aurons l'occasion d'y
voir nos premiers lémuriens, les plus petits de tous les primates,
une espèce de grosse souris aux grands yeux en raison de son mode de vie
nocturne, le microcèbe roux (Microcebus Rufus). Moins de
15 cm pour le corps et moins de 30 cm avec la queue et un poids moyen d'environ
50 grammes. Il y a un peu de tricherie pour les observer facilement. En écrasant
un peu de banane, on répond à leur régime alimentaire omnivore.
Il existe une autre espèce de lémurien nocturne dans cette
réserve, mais nous ne la verrons pas, les
lépilémurs (Lepilemur) qui
pèsent un peu moins d'un kilo.
Nous apercevrons également
des caméléons de couleur verte (la Réserve abrite
7 espèces de caméléons) dont
on peut observer l'extraordinaire capacité à mouvoir leurs yeux
de façon indépendante (d'où un champ de vision horizontal
de180° et vertical de 90°). Il s'agit de l'espèce rare de caméléon
vert belalanda (Furcifer belalandaensis).
Les
caméléons sont emblématiques de Madagascar car la moitié
des espèces existantes dans le monde y sont endémiques. Selon les
espèces, leur taille s'échelonne entre 2 et 50 cm.
Leurs mouvements de déplacement d'une seule patte à la fois sont
imperceptibles,
comme au ralenti, et leur corps est agité par un lent balancement qui simule
l'effet du vent sur les branchages.
Puis
ce sont des mantes religieuses (de bien drôles d'amantes et pas si
religieuses que ça, qui n'attendent parfois même pas la fin
de l'accouplement pour dévorer leurs amants !) également vertes,
tout cela se confondant parfaitement avec les feuillages, brindilles et branchages
qui les portent.
      | ||
Soirée et nuit à l'Ecolodge
![]() Dans une "ambiance refuge" la demi-pension incluse
dans le forfait nous offre un (trop) copieux dîner: soupe de légumes,
curry de poulet accompagné de riz et de feuilles bouillies de tétragone
(sorte d'épinard) et pour finir, un crumble à l'ananas.
Dans une "ambiance refuge" la demi-pension incluse
dans le forfait nous offre un (trop) copieux dîner: soupe de légumes,
curry de poulet accompagné de riz et de feuilles bouillies de tétragone
(sorte d'épinard) et pour finir, un crumble à l'ananas.
![]() La nuit ne
va pas être très reposante. Il fait vraiment frais à près
de 1500 m. De plus il y a du vent et les bungalows ne sont pas du tout étanches
aux courants d'air. Et tous ces bruits !
La nuit ne
va pas être très reposante. Il fait vraiment frais à près
de 1500 m. De plus il y a du vent et les bungalows ne sont pas du tout étanches
aux courants d'air. Et tous ces bruits !
Pendant la nuit les chiens
de garde du camp auront quelques épisodes d'aboiements. A l'aurore, dès
5 heures, ce seront d'autres bruits: concert de braiments d'ânes, de chevrotements
de chèvres et de chants de coqs, chocs proches de cognées et haches
des bûcherons suivis après un court silence des craquements du bois
lorsque des arbres s'abattent dans la forêt.
Mais ce voyage n'est-il
pas un peu placé sous le signe de l'aventure ?
Au fait pourquoi
toute cette ménagerie ? Daniel nous explique que cela permet l'autosuffisance
par rapport aux besoins en viandes et légumes-feuilles pour son restaurant.
![]() Après un petit-déjeuner continental,
nous faisons nos adieux à Patrick avant de partir à la découverte
de la réserve pendant la matinée. Cela tombe bien car ce temps est
mis à profit par Richard pour organiser le relais avec un autre véhicule
et un autre chauffeur.
Après un petit-déjeuner continental,
nous faisons nos adieux à Patrick avant de partir à la découverte
de la réserve pendant la matinée. Cela tombe bien car ce temps est
mis à profit par Richard pour organiser le relais avec un autre véhicule
et un autre chauffeur.
Balade
en forêt pour voir les lémuriens

![]() A 9 heures, bien chaussés,
nous partons tous les trois en visite sous la conduite de Jean-Baptiste
pou une randonnée facile, à portée de tout "petit marcheur".
A 9 heures, bien chaussés,
nous partons tous les trois en visite sous la conduite de Jean-Baptiste
pou une randonnée facile, à portée de tout "petit marcheur".
Notre guide est très aimable, parle très bien français
et connaît parfaitement son sujet mais gagne-t-il correctement sa vie ?
Sa mise permet d'en douter. C'est sans doute pour cela qu'il rêve de venir
en France qu'il voit comme un Eldorado. Nous essayons de lui faire comprendre
que pour lui la vie pourrait ne pas être si rose que cela chez nous...
Quelques mots sur la réserve: en 2012 elle couvre 2500 hectares
dont 500 ha de forêt d'eucalyptus, 1000 ha de pinède et
1000 ha constitués par un lambeau de forêt primaire. Les spécialistes
des lémuriens y ont observé jusqu'à six espèces de
lémuriens.
Parmi les espèces diurnes, signalons: l'hapalémur
gris (Hapalemur Griseus) ou lémur des bambous, 80cm queue comprise
(la queue mesure près de la moitié de la longueur totale de l'animal)
pour 1kg, le lémur à ventre roux (Eulemur rubriventer), 80-90cm
queue comprise pour environ 2kg et le rare et menacé sifaka ou propithèque
de Milne-Edwards (Propithecus Diadema Edwardsi), la troisième plus
grande espèce de lémuriens par sa taille d'environ un mètre
(queue comprise) pour 6 kilos.
Pendant une
partie de l'hiver austral, ils
hibernent dans
des terriers ou des arbres creux. A
la différence des autres espèces de sifaka, ils ont une robe sombre.
Cette espèce appartient à la famille des Indris et nous aurons la
chance d'en observer tout à l'heure.
Nous allons pendant un bon moment grimper à travers une forêt d'eucalyptus. Ce n'est pas un arbre endémique puisque originaire d'Australie mais il a été introduit par les colons il y a un siècle. Ce type de plantation couvre plus de 150 000 hectares à Madagascar. Son avantage, sa croissance rapide, grâce à ses feuilles qui produisent de la photosynthèse par leur deux faces, a pour contrepartie plusieurs inconvénients: il s'oppose à la biodiversité car il est invasif et quasi exclusif. De plus il appauvrit les sols. Il produit toutefois un excellent charbon de bois et après abattage, cet arbre a la faculté d'émettre des rejets. Avec le taillis qui en résulte, pas besoin de renouveler la plantation.
L'exploitation
de cette forêt est conduite de façon raisonnée: on n'abat
pas la totalité d'un secteur ce qui évite l'érosion. Ne sont
coupés que les arbres de taille moyenne qui correspondent à des
repousses de 3 ou 4 ans (avec
des haches, il serait difficile de s'attaquer à des arbres de 60 m
de haut et de 6 ou 7 m de circonférence).
Il n'est fait place
nette qu'à l'emplacement des charbonnières ou "meules"
qui ne sont pas hémisphériques comme en Europe mais sous forme de
parallélépipèdes.
Nous rencontrerons les bûcherons
et passerons près de nombreuses meules à divers stades de la fabrication,
de la mise en place des bûches et des branchages servant de combustible
à la mise en sac du charbon, en passant par la couverture en terre (afin
d'éviter l'apport d'air qui produirait la combustion alors qu'on recherche
seulement la carbonisation produite par une chauffe lente mais prolongée).
Le cycle de fabrication s'échelonne sur une semaine. Une charbonnière
fournit 30 sacs de 25kg. Autres infos: un sac est venu 3000 MGA (soit 6 fois
moins qu'en Somalie, un autre pays pauvre en train de se "déforester"
en exportant du charbon de bois) et il faut compter qu'en moyenne un malgache
consomme deux sacs par mois pour la cuisson soit une dépense de près
de 2 Euros et demi (pour un revenu moyen mensuel de 30 Euros). A savoir: le coût
d'une bouteille de gaz équivaut au salaire mensuel moyen !
Notre guide
nous fait découvrir l'étrange araignée-crabe qui ne
mord pas, bien que tenue au creux de la main, ainsi que des caméléons.
Puis ce sont des fourmilières et des termitières.
Arrivés
dans la pinède qui coiffe la colline, la végétation
de sous-bois se diversifie et l'on voit de nombreuses espèces d'orchidées
qui malheureusement ne sont pas en fleurs à cette saison. Si nous avons
souvent entendu le chant du courol vouroudriou ou coucou-rollier (Leptosomus
discolor), nous pourrons en observer un perché dans un arbre, de
taille intermédiaire entre pigeon ramier et tourterelle.
Au sommet de la colline un poste de défense avait été
ménagé dans une tranchée taillée dans le granit. Nous
avons une vue sur la vallée en contrebas et sur la colline voisine qui
sont recouvertes par la forêt primaire vers laquelle nous allons
nous diriger. De ce point de vue on aperçoit également la petite
ville d'Ambohimahasoa à quelques kilomètres de là.
 Jean-Baptiste communique par des cris avec deux pisteurs
que nous rejoignons en descendant vers la vallée. Ils ont repéré
un groupe de
propithèques de Milne-Edwards
(Propithecus edwardsi)
au pelage foncé et nous frayent un chemin
dans la jungle à grands coups de machette. Il faut
suivre leurs déplacements dans la cime des arbres. On peut admirer leurs
déplacements acrobatiques avec des sauts de branche en branche. Nous aurons
le loisir de voir cinq adultes avec leur tâche caractéristique
blanche au bas du dos et un bébé qui s'agrippe à sa
mère. L'heure n'est pas très
propice pour les observer car à 11 heures le soleil est presque au zénith
et du coup nous voyons les lémuriens à contre-jour.
Jean-Baptiste communique par des cris avec deux pisteurs
que nous rejoignons en descendant vers la vallée. Ils ont repéré
un groupe de
propithèques de Milne-Edwards
(Propithecus edwardsi)
au pelage foncé et nous frayent un chemin
dans la jungle à grands coups de machette. Il faut
suivre leurs déplacements dans la cime des arbres. On peut admirer leurs
déplacements acrobatiques avec des sauts de branche en branche. Nous aurons
le loisir de voir cinq adultes avec leur tâche caractéristique
blanche au bas du dos et un bébé qui s'agrippe à sa
mère. L'heure n'est pas très
propice pour les observer car à 11 heures le soleil est presque au zénith
et du coup nous voyons les lémuriens à contre-jour.
Jean-Baptiste
nous explique que ces animaux se déplacent. Ainsi, en deux jours ils peuvent
rejoindre la Réserve de Ranomafana distante de 40 km à "sauts
de lémurien".
Mais déjà il faut songer à
rentrer. Nous remontons vers la pinède puis redescendons vers le camp
au travers des eucalyptus.
![]() Midi.
Midi.
Nous retrouvons le restaurant de Daniel
qui nous sert une "salade de vermicelle" en entrée puis un curry
de porc accompagné de pommes de terre et de haricot. Un flan d'oeuf vient
terminer le repas.
Nous
commençons à nous inquiéter pour la suite car à
13 heures nous ne voyons toujours pas de véhicule...
On
repart sur la RN7 avec un nouveau chauffeur
![]() Un peu de patience et nous voyons arriver un 4x4, toujours un Japonais
de seconde main (volant à droite) mais cette fois il s'agit d'un Nissan
Patrol. Dominique, notre nouveau chauffeur-guide travaille pour Mad
Trekking, une agence de Fianarantsoa à laquelle Richard a demandé
de le dépanner.
Un peu de patience et nous voyons arriver un 4x4, toujours un Japonais
de seconde main (volant à droite) mais cette fois il s'agit d'un Nissan
Patrol. Dominique, notre nouveau chauffeur-guide travaille pour Mad
Trekking, une agence de Fianarantsoa à laquelle Richard a demandé
de le dépanner.
Dominique a une formation de guide et il a un moment
exercé cette activité mais, à celle-ci, il a préféré
la conduite. On n'en doute pas et on pourra constater qu'il conduit parfaitement
et calmement: vigilance, manoeuvres toujours sûres et respect des autres
usagers de la route, de quelque type que ce soit (petit chariots, piétons,
zébus, véhicules à l'arrêt).
Nous avons environ 80 km à parcourir pour atteindre Sahambavy, le terme de notre étape journalière. Nous poursuivons notre traversée du pays Betsileo. Nationale 7 toujours en mauvais état, troupeaux de zébus (un mois de sursis avant l'arrivée aux abattoirs de Tana), chariots petits mais pourtant encombrants, cultures en terrasses, feux de brousse, collines dénudées, fours à briques et un nouveau camion dans le fossé.
 | ||
Nous dépassons un étrange cortège, une troupe joyeuse et
endimanchée avec quelques personnes pourtant sur les épaules en
civière recouverte d'un linceul. S'agit-il de festivités pour une
première inhumation ou pour un rituel ultérieur de retournement des morts (famadihana) ?
Dans les pages consacrées à la route du sud-ouest (Isalo) et à l'ouest
(Morondava), je reviendrai de façon plus détaillée sur cette étrange et macabre
coutume.
Nous quittons la Nationale 7 en direction de l'est, par une petite route qui a un moment nous fait passer au-dessus de la ligne de chemin de fer reliant Fianarantsao à Manakara. Trajet que nous aurions dû effectuer le lendemain avec le train pittoresque s'il n'était pas tombé en panne... Justement, un sifflet de train ! Étrange ! A ce moment précis, nous longeons la voie sur notre droite et l'on voit venir soudain le fameux train qui n'est pas en panne mais quelque peu cassé avec sa locomotive toute de guingois, probablement à la suite d'un déraillement survenu il y a 11 jours, le 10 septembre. Avec seulement deux wagons au lieu des quatre habituels, à petite vitesse, le train regagne Fianarantsao et ne sera sans doute pas remis en service avant longtemps... La seconde motrice, hors d'usage depuis déjà longtemps, aura-t-elle encore assez de pièces de rechange à fournir à sa collègue ?
A l'approche du village de Sahambavy (avec sa petite gare et un hôtel au bord d'un joli lac ), la route devient carrément mauvaise. De son ancien revêtement ne subsistent que quelques plaques.
Il est 15 heures lorsque nous arrivons à Sahambavy ("le champ des femmes"), village de 17000 habitants.
La Manufacture de thé TAF (SIDEXAM)
Ici
la production du thé ne remonte pas très loin, une quarantaine d'années.
Les premières boutures venant du Kenya furent plantées en 1969-70
à l'initiative de l'Institut Français du Café et du Cacao
pour être testées dans un environnement a priori favorable (altitude
de 1250 m et climat humide). Cela abouti en 1978 à la construction
d'une première usine gérée alors par l’Etat. En 1996
les plantations furent privatisées au profit d’une société
anonyme, la SIDEXAM (Société d'Investissement et D'EXploitation
Agricoles de Madagascar), actuellement sous contrôle mauricien. Le domaine
compte près de 335 hectares (ou 385 ?) de plantations dont 94 hectares
sont gérés par les paysans eux-mêmes. Comme la transformation
du thé nécessite beaucoup d'énergie pour son séchage
qui doit être rapide, la Sidexam a planté une forêt d’eucalyptus
de 522 hectares pour la production de bois de chauffe.
La saison de la récolte
se situe entre les mois de septembre et mars. La production journalière
est en moyenne de 20 tonnes de feuilles humides, toutes ramassées à
la main, par environ 250 personnes, soit 80 kg par cueilleuse car il s'agit
évidemment de femmes ! A partir de 5 kg de feuilles vertes on
obtient 1 kg de thé séché. La production annuelle de
thé est d'environ 500 tonnes, principalement du thé noir. En dehors
de la vente directe, une part de la production est expédiée vers
Tana où elle est conditionnée en dosettes sous la marque TAF mais
l'essentiel, 80% de la production, est exporté (notamment vers la Bourse
de Mombasa au Kenya).
![]() La visite de la manufacture n'est pas passionnante. Après 15 heures,
il n'y a plus grande activité à voir. La plupart des machines (notamment
les rouleuses) sont arrêtées. Un coup d'oeil sur le banc de séchage
qui sert à ramener à 30% le taux d’humidité des feuilles
avant de les réduire en poudre et passage express dans le local d'ensachage.
La visite de la manufacture n'est pas passionnante. Après 15 heures,
il n'y a plus grande activité à voir. La plupart des machines (notamment
les rouleuses) sont arrêtées. Un coup d'oeil sur le banc de séchage
qui sert à ramener à 30% le taux d’humidité des feuilles
avant de les réduire en poudre et passage express dans le local d'ensachage.
L'employée peu motivée qui nous guide n'a qu'une hâte, celle
de nous conduire dans le magasin de vente.
Dans
les plantations de théiers
 Plus agréablement, puisque nous sommes
tout près de notre hôtel qui est au bord du lac, nous profitons d'un
peu de temps libre pour grimper sur la colline voisine au milieu des plantations
de théiers et nous y balader très tranquillement pendant une
heure sur les chemins d'exploitation de la plantation. Magnifique spectacle que
toutes ces collines couvertes de théiers qui descendent vers la vallée
et le lac. Mais le paysage est étrange car des parcelles entières
sont toutes grises, comme mortes. En y regardant de plus près, on se rend
compte qu'en réalité les théiers de ces parcelles ont été
sérieusement rabattus afin que repoussent de jeunes branches dès
la prochaine saison des pluies.
Plus agréablement, puisque nous sommes
tout près de notre hôtel qui est au bord du lac, nous profitons d'un
peu de temps libre pour grimper sur la colline voisine au milieu des plantations
de théiers et nous y balader très tranquillement pendant une
heure sur les chemins d'exploitation de la plantation. Magnifique spectacle que
toutes ces collines couvertes de théiers qui descendent vers la vallée
et le lac. Mais le paysage est étrange car des parcelles entières
sont toutes grises, comme mortes. En y regardant de plus près, on se rend
compte qu'en réalité les théiers de ces parcelles ont été
sérieusement rabattus afin que repoussent de jeunes branches dès
la prochaine saison des pluies.
Bientôt nous apercevons un groupe de cinq jeunes (on le devine à
leur tenue vestimentaire) qui gravissent la colline
en courant.
Où diable s'en vont-ils donc ? Nous aurons bientôt la réponse.
Ils nous rejoignent. Ce sont des lycéens, encore en vacances, et nous commençons
à parler de tout et de rien. De nous et surtout d'eux, de leurs études
et de leurs projets d'avenir. D'après leurs dires, ils sont bons élèves
et ne manquent pas d'ambition visant des métiers de médecin, avocat...
Justement, pour les aider à financer leurs études, voila qu'ils
sortent de leur sacoche, des cartes ornées de découpages qu'ils
nous proposent car leurs professeurs les dissuadent de mendier ! OK !
mais un petit conseil si vous faites ce type de rencontre, répartissez
de manière égalitaire vos achats sinon vous verrez la bonne humeur
générale se dissiper ("Et moi ? Et moi ?")...

Après notre bonne action auprès de Radoniaina Angelo
Rakotoarisoa et de sa joyeuse bande de copains repartis aussi vite qu'ils étaient
venus, nous nous asseyons pendant que le soleil baisse à l'horizon, face
à nous.
 | ||
Soirée
à l'hôtel du Lac
![]() Il est pratiquement 17 heures lorsque nous
arrivons à l'Hôtel
du Lac.
Il est pratiquement 17 heures lorsque nous
arrivons à l'Hôtel
du Lac.
Un petit saut en voiture pour aller à l'annexe
à 5 minutes de là. L'hôtel est superbe et son annexe n'est
pas mal non plus avec ses bungalows dans un petit parc, tout à côté
de la ligne de chemin de fer que nous aurions dû emprunter le lendemain
pour "descendre" vers Manakara.
![]() A 19 heures, retour à l'hôtel
pour dîner.
A 19 heures, retour à l'hôtel
pour dîner.
Cadre agréable et personnel stylé. Nos
choix se portent sur trois plats différents mais au même tarif (26000 MGA):
salade variée (tomate, chou-fleur, grains de maïs, oignon, carotte
râpée, haricots verts...) avec une friture de petit poissons, ) accompagnée
de pommes de terre sautées, feuilles cuites, petites tomates, croquette
de purée... et enfin un gros steak de zébu avec le même accompagnement
que le plat précédent. Ajoutons y une bouteille de vin (rouge à
11°) "Grand cru d'Antsirabe" pour 9000 MGA (un peu plus de
3 Euros). Il vient du Domaine de Saofierenana et est élevé par le
négociant d'origine chinoise Chan Fao Tong.
![]() Nuit calme. Aucun passage de train sur la
voie ferrée toute proche... Et pour cause !
Nuit calme. Aucun passage de train sur la
voie ferrée toute proche... Et pour cause !