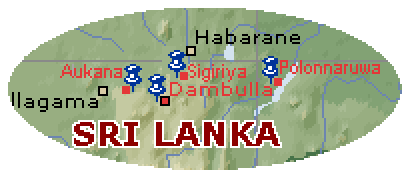 |
| |||
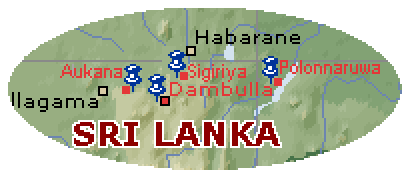 |
| |||
|
![]() Arrivée à Colombo
de bon matin (4h, il fait 25°).
Arrivée à Colombo
de bon matin (4h, il fait 25°).
Accueil
par Sina à l'aéroport situé à Negombo, à 37 km
au nord de Colombo.
Fatigués
mais avec une petite faim car il n'est pas prévu de petit-déjeuner.
Quelques
mots sur les petits plaisirs culinaires et gustatifs des Cinghalais... Ils consomment
beaucoup de thé préparé dans des sortes d'échoppes
ou d'officines à thé, les thay caday. Le mudalali
(le bistrotier local) y prépare un thé corsé mais coupé
de lait (en poudre) et copieusement sucré (trois cuillerées). Le
tout mis dans un shaker est vigoureusement touillé avec la cuiller... Une
autre façon de faire qu'en Inde. Mais ce n'est pas le genre de thé
que boivent les Occidentaux.
S'ils ont un petit creux, les Cinghalais vont
en profiter pour déguster une crêpe au lait de coco, des nids de
pâte de riz fourrés de mélasse, (sirop brun tiré de
la canne à sucre), des chaussons aux légumes épicés
ou des croquettes de lentilles pimentées...
![]() Départ pour Sigiriya (120 km),
sachant que le réseau routier de Ceylan ne permet guère de faire
des moyennes supérieures à 40 km/h...
Départ pour Sigiriya (120 km),
sachant que le réseau routier de Ceylan ne permet guère de faire
des moyennes supérieures à 40 km/h...
Le jour se lève
vers 6h30, lorsque nous quittons Colombo qu'il a fallu traverser car si l'aéroport
est bien au nord de la ville, il faut quand même redescendre vers Colombo
d'où partent les grands axes. Sortis de la ville, nous allons vers le nord-est.
Nous cotoyons les gens se rendant à leur travail (c'est samedi) et
sommes surpris de voir les motocyclistes porter un casque. Quant aux "équipages
familiaux motocyclistes" de 4 ou 5 personnes comme on peut le voir en Thaïlande
ou en Inde, ici ils sont plutôt rares.
Paysage
de cocoteraies (l'île en compte 416 000 ou 260 000 ha ???).
De la fleur, on tire un nectar qui sert de boisson, une sorte de vin, le toddy.
En le chauffant, on obtient un sirop épais. Fermenté et distillé,
on obtient un alcool, l'arrak (différent de l'arrak anisé
du Proche Orient). Bien sûr, la noix de coco permet d'obtenir le lait de
coco et sa pulpe râpée est largement utilisée dans la cuisine.
Après dessiccation de la pulpe, on peut en tirer de l'huile de coprah (alimentation,
savons...). Les fibres imputrescibles de la coque sont utilisées pour faire
des cordages, des balais ou des nattes. Quant au feuillage tressé, il sert
à couvrir les maisons tandis que du tronc on tire du bois de charpente...
Beaucoup
de circulation, plus mécanique qu'en Inde du sud. Beaucoup de véhicules
de marques indiennes Tata, Ashok Leyland (mais ces derniers assemblés au
Sri Lanka). Des véhicules des marques japonaises et coréennes (Toyota,
Nissan, Mazda, Usuzu) et même un camion Renault.
Sans oublier les omniprésents
et pétaradants auto-rickshaws ou tuck-tucks Bajaj, importés d'Inde.
Les pneumatiques sont aussi indiens (Birla Tires) mais le plus souvent bien usagés
et rechapés. Des marques de produits pétroliers que l'on n'est plus
habitués à voir chez nous (Caltex). Singer et Solex ( pompes à
eau) bénéficient d'une seconde vie en se réincarnant ici...
Paysage de cocoteraies et aussi paysage de rizières bien vertes,
ponctué de grosses collines rocheuses. Pour défendre les rizières
contre les prédateurs, de place en place, des cabanes de guet sont perchées
dans des arbres au milieu des parcelles. Le riz sera mûr dans quelques semaines.
Ici, on fait 2 récoltes, parfois 3, dans l'année. Le plus souvent
le riz est semé à la volée (sans repiquage) et son cycle
végétatif dure de 3 à 4 mois. On cultive une dizaine de variétés
de riz dans le pays.
Après la récolte, afin de faciliter la conservation,
le riz est étuvé et séché par les entreprises de conditionnement.
Les
scieries artisanales
sont nombreuses et utilisent un bois plus banal, souvent le cocotier pour en tirer
des éléments de charpente. Aussi des briqueteries familiales car
une partie des demeures sont construites en brique (tout comme de nombreux anciens
monuments, on le verra par la suite) et couvertes en tuiles (mécaniques
et plus traditionnellement de petites tuiles de forme ronde ou canal, genre tuiles
"romaines" ).
Premiers
signes du bouddhisme, religion majoritaire du pays: lieux cultuels avec des stupas
blancs en forme de cloches, bannières et drapeaux aux 5 couleurs du bouddhisme
(bleu, jaune, rouge, blanc et safran), temples villageois avec des statues du
Bouddha (assis ou debout) et aussi quelques modestes temples hindous.
Premiers
autres signes moins enchanteurs qui rappellent le terrorisme régnant dans
ce beau pays: les fréquents barrages dressés par l'armée
mais que notre autocar de touriste franchit allègrement.
Avant
1970, l'armée du pays se réduisait à 12000 hommes alors qu'actuellement,
elle en compte plus de 100000. C'est une armée de métier dans laquelle
on recrute des femmes comme on pourra souvent le voir en passant les barrages
routiers.
En
raison du terrorisme, notre circuit ne remonte pas jusqu'à la première
capitale, Anurâdhapura,
inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO dès 1982
![]() .
.
|
|
C'est aussi l'heure de la toilette sur les berges des rivières, lacs et dans les canaux pour les hommes torse nu avec leur sarong et pous les femmes en sari. L'heure de la lessive est passée car le linge et les vêtements sont mis à sécher au grand air, souvent disposés sur des haies et arbustes.
Des
constructions en voie d'achèvement sont confiées à la garde
d'épouvantails sensés chasser les mauvais esprits ou, plus exactement,
les empêcher de s'y installer...
Enfin,
SIGIRIYA se signale de loin par son imposant rocher émergeant de la forêt.
A
l'approche du site, la forêt a fait
l'objet de reboisement avec des essences précieuses: teck, palissandre,
acajou, ébène...
Les quelques maisons que l'on aperçoit au bord de la route, le plus souvent
ne payent guère de mine: petites, de facture sommaire, couvertes de tôles
plus ou moins rouillées...
D'autres
sont bâties selon un système du pan de bois avec remplissage en pisé
(et enduit de pisé sur le tout) et couverte de feuilles de cocotier tressées.
SIGIRIYA *** (voir plus loin les visites du jour 3)![]() Déjeuner à l'hôtel.
Déjeuner à l'hôtel.
Après l'installation dans
les bungalows dispersés dans un parc paysager tropical habité par
toutes sortes d'oiseaux colorés et bruyants (coucous, hérons des
rizières, martins-pêcheurs, aigrettes, perroquets...) et aussi par
des macaques, petits écureuils, tortues et varans...
Visite de la
ferme de l'hôtel.
Jardins aux légumes extraordinaires (gousse
de haricot de 50 cm). Plantation de goyaviers (l'arbuste pousse jusqu'à
6 m de haut et vit 5 ans).
Passage par la porcherie (porcs noirs et porcs-tomates
(!) à peau rouge) et par le poulailler.
|
|
![]() Visite du village en char à boeufs.
Visite du village en char à boeufs.
Ridicule et éclair (un quart d'heure)... Les 7 ou 8 touristes qui hissés
sur la charrette ont l'air de malfaiteurs conduits au supplice tandis que les
rares locaux les observent avec un air goguenard du pas de leur porte. Et en guise
de village, quelques misérables boutiques surgies là par les seuls
effets du tourisme. Une petite ondée sert de prétexte au charretier
pour interrompre prématurément sa prestation... que nous reprenons
derechef, mais cette fois à pied et sans accompagnateur...
Nous
en profitons pour jeter un coup d'oeil dans un atelier de sculpteur où
l'on peut voir nos premiers masques d'exorcisme (très colorés
et plutôt effrayants avec leurs yeux proéminents et leur denture
peu engageante), puis dans une boutique qui vend des tissus
et vêtements teints, ou plus exactement devrait-on dire, peints selon une
technique originale, le batik, dont on reparlera.
![]() Dîner et prise de contact avec la bière Lion
et musiciens au répertoire ...tahitien!
Dîner et prise de contact avec la bière Lion
et musiciens au répertoire ...tahitien!
![]() Nuit à l'hôtel. Eclairage
un peu à éclipses dans cette région plutôt perdue...
Nuit à l'hôtel. Eclairage
un peu à éclipses dans cette région plutôt perdue...
Le
Sri Lanka, comme l'Inde voisine, en raison de sa géologie, ne dispose pas
de ressources pétrolières. Environ 80% de l'électricité
est d'origine hydraulique.
Il y aurait toutefois des possibilités de
ressources off-shore, au nord-est de l'île, dans le prolongement de gisements
sous-marins indonésiens. La Norvège (qui jouait les Messieurs bons
offices jusque il y a peu dans la guerre civile) participe à la prospection
mais la Chine pointe aussi le bout de son nez. Ce pourrait aussi être un
grand malheur pour ce petit pays en guerre civile car cela pourrait exacerber
le projet indépendantiste tamoul.
![]() Petit déjeuner.
Découverte d'une spécialité du pays, une sorte de yaourt
ou de fromage blanc fait à partir de lait de bufflesse et qui se déguste
avec du sirop de palme ou avec du miel. Les plus téméraires peuvent
aussi l'agrémenter avec de l'oignon ou du piment!
Petit déjeuner.
Découverte d'une spécialité du pays, une sorte de yaourt
ou de fromage blanc fait à partir de lait de bufflesse et qui se déguste
avec du sirop de palme ou avec du miel. Les plus téméraires peuvent
aussi l'agrémenter avec de l'oignon ou du piment!
![]() Départ vers l'est en direction de
Polonnaruwa (environ 65 km dont 13 en forêt).
Départ vers l'est en direction de
Polonnaruwa (environ 65 km dont 13 en forêt).
Au bord de
la route, divers aperçus de la vie locale: une petite école toute
violette et ouverte aux quatre vents, une moissonneuse-batteuse se déplaçant
sur la route (ce sera la seule que l'on verra), quelques chargements de sacs (de
riz?), panneaux de propagande, baignade et lessive dans les rivières...
Arrêt dans un atelier de sculpture sur bois précieux: Bouddha, divinités
hindoue, masques d'exorcisme...
|
Plus
récent, le Mahavamsa (ou Généalogie de la Grande Dynastie),
récit du mythe cinghalais date du VIe s. dont le cadre de départ
est le Bengale, au nord de l'Inde. Des prédictions annoncèrent lors
de la naissance de la princesse Suppa Devi que son destin serait de s'unir à
un lion (rien que ça!). Evidemment le destin devait se réaliser
et pour cela elle échappa à la vigilance de son père et fut
enlevée par un lion dont elle eut un fils, Sinha Bahu, et une fille, Sinha
Valli. Anuradhapura
fut fondée au milieu de Ve s. av. J-C et devint bouddhiste deux siècles
plus tard. Elle fut abandonnée au VIIe s.
|
POLONNARUWA
***
Polonnaruwa
était un haut lieu du bouddhisme (l'une des 16 étapes que l'on prête
au Bouddha en terre de Lanka). Au IVe s., le moine chinois Fuxian relatait
qu'un complexe monastique y accueillait 10 000 moines (importance attestée
par l'archéologie)...
Le site archéologique de
Polonnaruwa qui
a été reconquis sur la jungle (comme Anuradhapura) est inscrit au
Patrimoine Mondial de l'UNESCO
![]() depuis 1982.
depuis 1982.
Du
début de notre ère jusqu'au XIIe s., les Cinghalais créèrent
quelque 80 000 retenues d'eau complétées par 1000 km de
canaux d'irrigation. le lac Parakrama Samudra qui couvre 2400 ha fut créé
à l'apogée de cette civilisation de l'eau et juste avant son brusque
déclin. Il s'agissait d'améliorer la fertilité des sols dans
les zones où étaient établies les capitales (Anudhapura antérieurement
puis Polonnaruwa) soumises à l'alternance des saisons sèches et
humides.
Toute cette organisation exceptionnelle fut laissée à
l'abandon et les lacs devinrent des marécages paludéens... jusqu'à
ce qu'au XXes. on se soucie de les remettre en état.
Après la destruction d'Anuradhapura par les Cholas du sud de l'Inde
en 933, ceux-ci firent de Polonnaruwa leur capitale car elle était plus
accessible à leurs bateaux en empruntant le fleuve Mahaweli Ganga.
Des
monuments ont conservé l'influence de l'architecture hindoue de l'Inde
méridionale.
Les
Cingalais s'en emparèrent au XIe s. et elle devint leur capitale.
Ils affirmèrent leur puissance en développant un style de statuaire
bouddhique colossale.
Le
roi Parakrama Bahu fut
à l'origine du grand lac (réservoir
Parakrama
Samudra) qu'il fit
réaliser grâce à une digue de 12ou 13 km de long et
grâce à des canaux l'alimentant, ce qui permit de réunir trois
anciens petits lacs.
Elle connut son
apogée aux XIe-XIIe s. avant d'être abandonnée à
la suite d'une nouvelle invasion tamoule et envahie par la jungle.
Belles et nombreuses ruines de palais, dagobas, temples et bassins...
Les dagobas (leur
forme rappelle celle du bol à riz retourrné des moines mendiants)
sont les véritables emblèmes de l'architecture bouddhique
(souvent connus sous le terme générique de stupas).
Ce
sont des reliquaires en forme de cloches construits en briques recouvertes d'un
stuc (sorte de crépi blanc). Ils sont couronnés par "la maison
des dieux", karmita, elle-même surmontée par un toit
symbolique, chattra.
Inspiré
des tumulus, le modèle adopté au IIIe s. était celui
d'un dôme recouvert d'un enduit (stuc) posé sur une triple terrasse
en gradin et surmonté d'un tabernacle. Par la suite, les construction se
sont sophistiquées en perdant une partie de leur forme originelle.
Les fidèles en
font le tour dans le sens des aiguilles d'une montre (sens positif) et déposent
des offrandes sur les tables à fleurs, autels situés au niveau des
porches s'ouvrant en direction des quatre points cardinaux.
Ces
temples sont inspirés des stupas indiens. A l'origine, il s'agit de reliquaires
destinés à accueillir des restes du corps du Bouddha voire ...d'une
empreinte de ses pas!
![]() La
visite commence par le Musée Archéologique, l'un des plus
beaux du pays, donnant une excellente présentation du site et les explications
techniques nécessaires pour comprendre à quoi correspondent les
vestiges de ce site exceptionnel.
La
visite commence par le Musée Archéologique, l'un des plus
beaux du pays, donnant une excellente présentation du site et les explications
techniques nécessaires pour comprendre à quoi correspondent les
vestiges de ce site exceptionnel.
L'enceinte extérieure de la citadelle
mesurait 6 km de long, s'élevait jusqu'à 11 mètres et
était percée de 14 portes. Le site fut pillé et détruit
lors d'une grande invasion tamoule au début du XIIIe s. .
Nous
avons quasiment le site pour nous seuls.
|
|
![]() Dans
la citadelle, visite des ruines du Palais royal du roi
Parakrama Bahu (1153-1186). Il comportait 6 étages (il reste des vestiges
des deux premiers niveaux) et comptait paraît-il quelque 1000 pièces.
Des poteaux de bois noyés dans le maçonnerie servaient à
supporter la charge des étages supérieurs. La construction était
recouverte de stuc dont il subsiste quelques traces.
Dans
la citadelle, visite des ruines du Palais royal du roi
Parakrama Bahu (1153-1186). Il comportait 6 étages (il reste des vestiges
des deux premiers niveaux) et comptait paraît-il quelque 1000 pièces.
Des poteaux de bois noyés dans le maçonnerie servaient à
supporter la charge des étages supérieurs. La construction était
recouverte de stuc dont il subsiste quelques traces.
|
|
Ruines de la Salle du Conseil dont le rebord de la terrasse est orné de trois frises: éléphants, lions et nains (comme dans les temples hindous de l'Inde voisine).
|
|
Ruines du Hatadage. Vaste sanctuaire (38x27 m). L'escalier à deux volées est précédé d'une pierre de lune. Il portait un étage où était abritée la Dent du Bouddha.
|
|
Ruines
du Vatadage (littéralement "maison des reliques"), l'un
des plus anciens édifices du site et témoin d'un style d'architecture
religieuse particulière au Sri Lanka.
Il se présente sous
forme d'une plate-forme circulaire à deux niveaux. On y accède par
des escaliers placés aux quatre points cardinaux. Le dagoba central était
protégé par un toit conique qui reposait sur les murs et piliers
périphériques.
|
|
Ruines de l'Atadage, premier temple dédié à la Dent de Bouddha, avec des éléments récupérés à Anuradhapura. Il comportait un étage en bois.
|
|
Ruines du Satmahal Prasada. Stupa de style khmer (XIIe s.).
|
|
Le Gal Pota ou "Livre de pierre". Cette énorme dalle (8,20x1,20x1,00 m soit environ 30 tonnes) provenant d'une carrière située à 90 km est gravée de textes.
Le sites comporte de nombreux autres vestiges: Bain du Prince, des vestiges de temples hindous (notamment des temples de Shiva en raison des épouses royales d'origine tamoule), d'anciennes échoppes, des centaines de vestiges d'édifices monastiques s'étendant au nord de la Citadelle, ce complexe ayant encoire hébergé jusqu'à 3 000 moines au XIIe s....
![]() En
remontant le site vers le nord, nous passons au pied du Rankot Vihara (fin
du XIIe s.), avec ses 60m de haut, c'est le plus grand dagoba du site. Puis
nous franchissons la porte nord pour pénétrer dans le complexe monastique
(hôpital, cellules...).
En
remontant le site vers le nord, nous passons au pied du Rankot Vihara (fin
du XIIe s.), avec ses 60m de haut, c'est le plus grand dagoba du site. Puis
nous franchissons la porte nord pour pénétrer dans le complexe monastique
(hôpital, cellules...).
|
|
Ruines du Lankatilaka**, dans un décor d'inspiration indienne (colonnes, frises). Ses murs de 4 m d'épaisseur s'élévent encore à 17 m mais une voûte disparue culminait à 30 m. Cette "maison de l'image" abrite un grand Bouddha fait de brique et de stuc, très dégradé. Il se dresse face à une salle hypostyle.
|
|
Le Kiri Vihara. Ce dagoba bien conservé était originellement peint à la chaux.
|
|
Toilettes "à la turque" du monastère de Pollonnaruwa...
![]() Visite du Kalu
Gal Vihara*** ou "monastère de pierre noire".
C'est une partie d'un autre ensemble monastique fondé toujours par Parakrama
Bahu au XIIe s. De splendides et gigantesques statues monolithiques de Bouddha,
taillées dans le gneiss sont protégées par un inesthétique
auvent. Mais sans protection, quel aspect auraient-elles (verdâtre?).
Visite du Kalu
Gal Vihara*** ou "monastère de pierre noire".
C'est une partie d'un autre ensemble monastique fondé toujours par Parakrama
Bahu au XIIe s. De splendides et gigantesques statues monolithiques de Bouddha,
taillées dans le gneiss sont protégées par un inesthétique
auvent. Mais sans protection, quel aspect auraient-elles (verdâtre?).
On
peut y admirer quatre statues du
XIIe s sculptées à même
le roc de la falaise et en parfait état.
A
l'origine les statues étaient peintes. On y admire
un Bouddha assis auréolé de 5 m, un Bouddha**
de 11 m et surtout un impressionnant Bouddha*** de 14 m, couché
pour l'éternité. Ce Bouddha dans la position de la "grande
extinction",
la tête reposant sur un oreiller,
dégage une grande sérénité. Les plis de la robe sont
parfaits. D'après les spécialistes, bien des siècles après,
on retrouve là l'influence de la plastique hellénistique (exportée
en Inde du nord par Alexandre au IIIe s. av. J-C). Face à ce Bouddha
couché, se dresse un ficus, un arbre Bô, enrubanné de drapeaux
de prières et au pied duquel sont déposées des offrandes.



Nous quittons le site à l'heure où les écolières rentrent déjeuner, tout comme les paysans agglutinés dans la carriole d'un motoculteur transformé en véhicule de transport en commun.


![]() Déjeuner à base de curries divers (viandes, poissons
et surtout légumes).
Déjeuner à base de curries divers (viandes, poissons
et surtout légumes).
![]() Retour à
Sigiriya
(80 km environ).
Des maisons de factures très diverses, modernes (un crépis bien
vert qui se fond dans l'environnement!), maisons traditionnelles plus ou moins
dénaturées par l'adjonction de parties neuves avec des grandes fenêtres
ou des toit en tôles métalliques ou en amiante-ciment (l'utilisation
de ce matériau nocif pour la santé se poursuit toujours dans ce
pays), ces dernières étant parfois dissimulées sous des tuiles
canal...
Retour à
Sigiriya
(80 km environ).
Des maisons de factures très diverses, modernes (un crépis bien
vert qui se fond dans l'environnement!), maisons traditionnelles plus ou moins
dénaturées par l'adjonction de parties neuves avec des grandes fenêtres
ou des toit en tôles métalliques ou en amiante-ciment (l'utilisation
de ce matériau nocif pour la santé se poursuit toujours dans ce
pays), ces dernières étant parfois dissimulées sous des tuiles
canal...
Le
trajet n'en finit pas.
Première cause: la route est en voie d'élargissement
mais si les chantiers sont commencés un peu partout, ils ne sont finis
nulle part! De nombreuses femmes cantonnières ou terrassières s'y
affèrent.
Seconde cause: les nombreux barrages de l'armée qui
ponctuent le trajet. Notre autocar de tourisme passe évidemment les chicanes
sans subir de contrôle ce qui n'est pas le cas des bus locaux qui sont fouillés
et dont les passagers doivent descendre pour se présenter à un poste
de contrôle d'identité.
|
|
![]() En milieu d'après-midi,
nous faisons étape chez une famille afin de visiter une
maison traditionnelle. La base des murs,
à l'extérieur, et le sol sont recouverts d'un mélange de
terre et de bouse (pour éloigner les parasites). Les murs sont faits d'un
colombage servant d'armature, un clayonnage
en bois de cocotier, et de pisé (20% des habitations du pays seraient encore
construites selon ces techniques). Cela n'est pas sans rappeler les techniques
des anciennes maisons à pans de bois
d'Occident.
En milieu d'après-midi,
nous faisons étape chez une famille afin de visiter une
maison traditionnelle. La base des murs,
à l'extérieur, et le sol sont recouverts d'un mélange de
terre et de bouse (pour éloigner les parasites). Les murs sont faits d'un
colombage servant d'armature, un clayonnage
en bois de cocotier, et de pisé (20% des habitations du pays seraient encore
construites selon ces techniques). Cela n'est pas sans rappeler les techniques
des anciennes maisons à pans de bois
d'Occident.
Sur une charpente de bambou, le toit est un tressage de feuilles
de cocotier qui doit être renouvelé au bout de 18 mois.
Le plan
est simple, un rectangle divisé en quatre pièces sensiblement égales,
sans fenêtres. Côté façade, une porte conduit à
une première pièce, sorte de vestibules et pièce de réception
où se trouve un petit autel. Une porte à droite ouvre sur une première
chambre et une autre porte, au fond, donne sur la seconde chambre. Il faut y pénétrer
pour passer, à gauche, une autre porte qui mène à la cuisine
très enfumée mais qui donne sur l'extérieur par une porte
située à l'arrière. Mais la modernité est quand même
là car il y a l'électricité.
Je
n'ai pas posé la question de savoir combien de personnes vivaient sous
ce toit. Probablement une demi-douzaine.
La
visite a été complétée par des démonstrations
de la maîtresse de maison. Décorticage du riz à l'aide d'un
mortier et d'un pilon harmonieusement et alternativement lancé d'une main
puis de l'autre. Pour compléter, vannage du riz décortiqué
pour en retirer la balle (une autre technique qui ne nous est pas présentée
consiste à se réhausser en se plaçant sur un sorte de trépied
afin d'avoir plus de hauteur et de profiter ainsi d'un plus fort courant d'air
pour séparer la balle).
Les grains de riz brisés servent à
préparer des potages et ils peuvent être réduits en farine
pour la préparation des galettes, crêpes et pâtes srilankaises.
Démonstration également de préparation de la sauce de piment
(écrasé).
SIGIRIYA
***
Retour au rocher... l'ascension des quelque 800
marches se fera donc dans la chaleur de fin d'après-midi. Une bonne heure
de montée en perspective... et un site
pour nous seuls (ce n'était pas le cas la veille car du village on voyait
un groupe de moines au sommet).
Le site de Sigiriya est inscrit au Patrimoine
Mondial de l'UNESCO
![]() depuis 1982.
depuis 1982.
![]() Visite de la
forteresse du Lion, ce nom évoque l'ancêtre mythique des souverains
de l'île (Sinhala,
Fils de Lion).
Visite de la
forteresse du Lion, ce nom évoque l'ancêtre mythique des souverains
de l'île (Sinhala,
Fils de Lion).
Le "château
céleste" fondé au Ve s. par le roi parricide Kassyapa
(il fit emmurer vivant son propre père pour s'emparer du trône car
il craignait d'en être écarté au profit de son demi-frère,
dans la mesure où il était né d'une mère non noble)
qui déplaça la capitale depuis Anuradhapura sans doute pour fuir
ses remords et se mettre à l'abri de représailles. Cette forteresse
est édifiée autour d'un monolithique massif de pierre rouge qui
domine la jungle de 200 m. (ou 140? ou 370?). Ce roi mégalomane
qui avait fait appel aux plus grands artistes de son temps, voulait disposer d'une
citadelle inexpugnable... Pourtant il fut chassé du trône (en fait,
vaincu, il se suicida) par son demi-frère revenu d'Inde avec une armée,
18 années après le début de son règne (477 à
495).
Le site fut abandonné et le palais fut détruit un siècle
plus tard.![]() A
la base du rocher, direction plein ouest, après
avoir franchi des douves et anciennes fortifications de brique, nous pénétrons
dans les jardins.
A
la base du rocher, direction plein ouest, après
avoir franchi des douves et anciennes fortifications de brique, nous pénétrons
dans les jardins.
Dans une ordonnance à
la française, nous traversons une succession de jardins remis en
état: jardin miniature, jardin d'eau, jardin de la fontaine où s'élevaient
des pavillons et palais. Il faut se
débarrasser de sherpas et faux-guides particulièrement collants...
Le
cheminement s'élève pour entrer dans la citadelle sur les premières
pentes de laquelle sont suspendus des jardin de rocaille
qui étaient occupés une bonne partie par un monastère. Sous
le surplomb des gros rochers, formant de sortes de grottes, s'adossaient des constructions
(on voit les entailles où se logeaient les pièces de charpente)
dont la façade était constituées de poteaux et de murs de
brique. Une encoche en larmier ceinturait le haut des blocs afin d'empêcher
le ruissellement dans le creux des rochers. On discerne encore des traces d'écritures
et de fresques. Après la mort du prince, cette partie du site fut occupée
par des ermites.
Après une arche naturelle, le cheminement devient
plus aérien. Pour arriver aux grottes situées à mi-hauteur,,
il faut emprunter un étroit escalier métallique en colimaçon
accroché à la falaise. L'effort joint à la chaleur qui rayonne
de la falaise surchauffée nous fait transpirer abondamment.
![]() A
mi-hauteur, sur la face ouest du rocher, profitant de la meilleure lumière,
celle de fin de journée (flash interdit), découverte des fresques
aussi célèbres que mystérieuses des 12 "Demoiselles
de Sigiriya" ou "Demoiselles des Nuages", âgées
de 15 siècles. Selon la tradition, il y en aurait eu 550 à l'origine
et ces figures auraient comme enveloppé la paroi du rocher. Elles
furent redécouvertes par les Anglais en 1831.
A
mi-hauteur, sur la face ouest du rocher, profitant de la meilleure lumière,
celle de fin de journée (flash interdit), découverte des fresques
aussi célèbres que mystérieuses des 12 "Demoiselles
de Sigiriya" ou "Demoiselles des Nuages", âgées
de 15 siècles. Selon la tradition, il y en aurait eu 550 à l'origine
et ces figures auraient comme enveloppé la paroi du rocher. Elles
furent redécouvertes par les Anglais en 1831.
Kassyapa,
prince fou était sans doute aussi un esthète...
La beauté
(impudique pour les puritains) et le mystérieux sourire de ces personnages
mi-déesses, mi-princesses, ne se sont pas altérés en 15 siècles.
Accompagnées de servantes (à la peau foncée), elles
portent des offrandes en se dirigeant toutes dans la même direction, celle
du temple bouddhiste voisin. De la fresque d'origine, ne subsistent qu'une douzaine
de demoiselles représentées avec des couleurs appliquées
sur une base d'huile et de colle.
|
|
|
|
Il
faut reprendre un escalier pour redescendre un peu et atteindre le passage en
balcon ménagé derrière le parapet du "miroir".
Ce parapet a servi de support à des graffitis laissés par des "touristes"
des VIII-IXe s. exprimant leur admiration pour la beauté des demoiselles...
Bref
moment pour souffler sur la terrasse du Lion, située sur le côté
nord du rocher. De l'avant du corps de lion qui devait être représenté
couché et était construit en brique et stuc, ne subsistent que les
pattes.
L'accès à la terrasse du sommet se fait par un escalier qui débute entre ces pattes. Cet accès rebute certains d'entre nous... La succession de volées d'escaliers métallique voisine avec les anciennes marches taillées à même le rocher.
![]() Arrivés
au sommet du rocher, les
courageux sont récompensés par une vue imprenable*** sur
le paysage de forêts verdoyantes qui s'offre depuis le sommet sur les environs
(le Pic d'Erawalagala au sud) et sur les jardins et tout cela avec la fabuleuse
lumière d'un soleil couchant.
Arrivés
au sommet du rocher, les
courageux sont récompensés par une vue imprenable*** sur
le paysage de forêts verdoyantes qui s'offre depuis le sommet sur les environs
(le Pic d'Erawalagala au sud) et sur les jardins et tout cela avec la fabuleuse
lumière d'un soleil couchant.
Au sommet du rocher, le roi fou avait construit un palais de 15000 m² (le roi y entretenait 500 concubines!) dont les murs étaient paraît-il habillés de miroirs afin que les nuages et le ciel s'y reflètent. Il n'en subsiste que des fondations et un bassin.
Désormais, ce sont des macaques un peu agressifs qui habitent le site.

Il reste à redescendre dans la lumière du crépuscule, à passer près d'un charmeur de serpents (cobra et python), à profiter de la descente qui les met mieux en valeur pour redonner un coup d'oeil sur le rocher de la salle d'audience (avec un trône de 5 m de largeur) puis à l'énorme rocher en forme de cobra près duquel on passe.
![]() Dîner. Ce soir un autre groupe de musiciens
nous offre un répertoire ...mexicain!
Dîner. Ce soir un autre groupe de musiciens
nous offre un répertoire ...mexicain!
![]() Nuit à l'hôtel.
Nuit à l'hôtel.
![]() En
raison des risques terroristes, notre circuit ne nous conduit pas à Anurâdhapura,
la plus ancienne des villes royales de l'île dont les ruines sont enfouies
dans une végétation luxuriante.
En
raison des risques terroristes, notre circuit ne nous conduit pas à Anurâdhapura,
la plus ancienne des villes royales de l'île dont les ruines sont enfouies
dans une végétation luxuriante.
![]() Départ pour Aukana (45 km environ).
Au menu du spectacle qui se présente au long du trajet: le bain d'un éléphant,
une fête villageoise avec une dizaine d'attelages de boeufs sur des charrettes
(nous n'en verrons jamais autant pendant tout le voyage) décorées
de ballons de baudruche de toutes les couleurs, des rizières avec des cabanes
de guet perchées...
Départ pour Aukana (45 km environ).
Au menu du spectacle qui se présente au long du trajet: le bain d'un éléphant,
une fête villageoise avec une dizaine d'attelages de boeufs sur des charrettes
(nous n'en verrons jamais autant pendant tout le voyage) décorées
de ballons de baudruche de toutes les couleurs, des rizières avec des cabanes
de guet perchées...
![]() A propos de rizières, Sina nous propose une petite balade dans les rizières.
Le riz est bien vert mais bien en épis. Il reste de l'eau dans les rigoles
principales et un héron des rizières est là pour pêcher
sa pitance. Une très longue couleuvre se repose ou digère quelque
rongeur à l'ombre d'arbrisseaux.
A propos de rizières, Sina nous propose une petite balade dans les rizières.
Le riz est bien vert mais bien en épis. Il reste de l'eau dans les rigoles
principales et un héron des rizières est là pour pêcher
sa pitance. Une très longue couleuvre se repose ou digère quelque
rongeur à l'ombre d'arbrisseaux.
Dans
ce pays on compte 89 sortes de serpents ! Certains sont des auxiliaires des paysans
tout comme le sont les mangoustes (petits mammifères carnivores) qui protègent
les cultures contre les rongeurs.
Le pays compte
près d'un million (ou un demi-million ???) d'hectares de rizières
qui lui permettent d'assurer son autosuffisance depuis 2002. La culture occupe
le terrain de 3 à 4 mois et une culture de haricots est souvent intercalée
entre deux cultures de riz. De temps à autre, afin de réduire les
dommages dus aux insectes, les paysans font pousser une sorte de marguerite sauvage
qui produit du pyrèthre, un insecticide naturel. Le rendement est de l'ordre
de 40 quintaux par hectare. De grandes fêtes villageoises sont organisées
en mars, après la principale récolte. La culture est désormais
largement mécanisée (tracteurs, motoculteurs).
Les rizières
appartiennent à l'Etat qui gère et entretient les retenues d'eau
et les canaux d'irrigation. Une surface d'un hectare est mise gratuitement à
la disposition de chaque famille (dans ce pays, les grandes propriété
privées sont celles des temples, des cocoteraies et des plantations). Des
bornes jaunes aux marques de l'Etat sont visibles au bord du sentier.
AVUKANA ** (prononcer Aukana)
C'est l'un des quelque
cent villages voisins du réservoir Kala Wewa construit au Ve s.
(restauré au XIIe s. puis laissé à l'abandon par la
suite puis de nouveau remis en service depuis le XIXe s.). Sur deux kilomètres,
nous empruntons la digue au bout de laquelle une statue a été érigée
en l'honneur du roi Dhatusena auquel on doit la création de ce lac de 50 000 ha,
il y a 2500 ans!
![]() Peu de moines résident sur le site qui est d'ailleurs peu fréquenté.
Au bas du site, des petits dagobas commémorent la mémoire d'anciens
abbés. Pour la visite, il faut se déchausser.
Peu de moines résident sur le site qui est d'ailleurs peu fréquenté.
Au bas du site, des petits dagobas commémorent la mémoire d'anciens
abbés. Pour la visite, il faut se déchausser.
|
|
|
La
religion bouddhiste a un tel rôle symbolique que de manière formelle
le pouvoir temporel est placé à un niveau inférieur (dans
une assemblée, un moine occupe une position plus élevée qu'un
dirigeant politique du pays). Il est vrai que ce pays revendique trois visites
éffectuées jadis par le Bouddha lui-même, venu par voie des
airs (!) honorer 16 lieux de ce pays... Des
ermitages sont aussi présents dans les forêts et il est possible
d'y admirer une forme d'art minimalistes des jardins qui n'est pas sans faire
penser au zen japonais (héritier de la secte bouddhiste chinoise
chan) .
|
Magnifique et immense Bouddha monolithique debout, de 12 m de hauteur (14 ou 15 ? avec le socle) taillé directement dans le roc. Tourné vers l'est, on le dit "mangeur de soleil"! Si ce n'est la plus haute statue ancienne de Bouddha au Sri Lanka, c'est la plus belle tant par l'attitude que par les traits et les plis parfaits de sa robe (drapé dit "mouillé").
Cette
colossale statue de Bouddha en geste de bénédiction dont on dit
qu'elle se nourrit du soleil, porte son regard en direction du réservoir.
Selon la tradition (mythique), la sculpture aurait été réalisée
à la demande du roi Dhatusena au Ves. av. J-C. mais selon certains, elle
serait en fait datée entre
le VIe et le VIIIe s. Elle était abritée alors par un sanctuaire
(vestiges de fondations).
Ce chef d'oeuvre de l'art cingalais est la statue
la mieux préservée de l'île.
Un
arbre bô avec ses drapeaux de prière et un dagoba
moderne formant chapelle et au décor peint très kitsch complètent
le site.
D'énormes ossements qui traînent dans un coin nous intriguent,
il s'agit de ceux d'un pachyderme.
![]() Départ pour Dambulla (20 km environ).
Départ pour Dambulla (20 km environ).
DAMBULLA *
|
|
C'est dans cette petite
ville, centre géographique de l'île, que le roi du pays, chassé
d'Anuradhapura lors d'une invasion tamoule, trouva refuge au Ier s. av. J - C
et lui conféra un caractère religieux.
Plus concrètement,
cette bourgade est un vrai centre de la vie locale.
Avant de déjeuner nous profitons d'un arrêt d'une demi heure pour arpenter la rue principale à l'heure où le commerce est en pleine activité. C'est l'occasion de constater la présence d'ONG (japonaise).
Les visiteurs les plus flémards s'arrêteront au niveau du village
où ont été édifiés un dagoba moderne doré
et surtout une immense et sévère Bouddha de béton également
bien doré, surmontant le très kitsch "Golden Temple",
une sorte de supermarché religieux à façade en forme de lion!
Cette réalisation remonte à 1997.
C'est
le plus grand des sanctuaires rupestres de Sri Lanka. Le roi Vattagamani chassé
d' Anuradhapura y avait trouvé temporairement refuge au Ier s. av.
J - C, face aux envahisseurs tamouls. Témoignage de sa reconnaissance
et de la prodigalité
de princes du XIIIe et du XVIIIe s., les
cinq grottes sont devenues un somptueux sanctuaire bouddhiste décoré
de fresques remarquables et de statues colorées, un véritable trésor.
Le
site est inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO
![]() depuis 1991.
depuis 1991.
Les
grottes creusées à mi-hauteur dans un énorme bloc de granit
sont perchées à 160 m au-dessus de la plaine (de la terrasse
on aperçoit le rocher de Sigiriya) et s'étendent sur 2100 m²
et comportent 157 statues.
L'accès au site nécessite donc de
gravir quelques centaines de marches et de grimper quelques sentiers aménagés
sur de gros rochers.
Peu de visiteurs et des pélerins eu nombreux...
|
|
![]() Rocher aux 5 temples ou grottes-monastères abritant 150 statues
(ou 155 ou seulement 112 selon certaines sources???) de Bouddha et de
bodhisattvas.
Rocher aux 5 temples ou grottes-monastères abritant 150 statues
(ou 155 ou seulement 112 selon certaines sources???) de Bouddha et de
bodhisattvas.
Elles remontent à de époques très diverses allant du Ier siècles avant J-C au XIXe s. et se présentent au visiteur dans cet ordre.
Pour
la visite, il faut se déchausser et une tenue décente est exigée
(épaules nues et shorts sont bannis).
La grotte du Roi Divin Deva Raja Vihara (dite grotte n°1) abrite un beau Bouddha couché datant du Ier siècle av.J-C, monolithe de 14 m de long taillé dans le granit. La peinture décorant la plantes des pied est originale. Les fresques du XVIIIe s. sont abîmées. L'étroitesse de la grotte rend la prise de photo très difficile.
Dans
la Grotte des Grands Rois Maharajalena ou Maharaja Vihara (dite grotte
n°2), la plus vaste (53x23 m), on peut admirer une cinquantaines de statues
anciennes de Bouddha et de quelques bodhisattvas. On y voit encore un immense
Bouddha couché (15 m). Autre statue de Bouddha assis, protégé
sous le capuchon de trois cobras déployés au-dessus de sa tête
(les superstitions populaires font que le nombre de cobras est toujours impair,
généralement de 1 à 7). Au XIIe s., les statues étaient
recouvertes d'or (on en voit quelques traces). On peut également y voir
les statues en bois des dieux hindous Vishnu et Saman !
Il faut aussi admirer
les parois et le plafond (à 7 m de haut) recouverts de superbes fresques
murales consistant en motifs géométriques, petites effigies du Bouddha
par centaines et en scènes relatant la vie de Bouddha. Elles datent du
XVIIIe s. et sont abîmées.


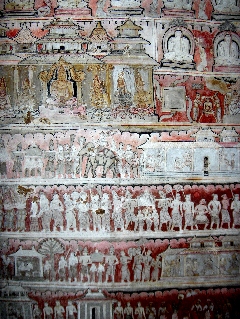
La Grotte Maha Alut Vihara (dite grotte n°3), est moins vaste et plus basse de plafond que la seconde. Encore beaucoup de fresques de la même époque (la décoration originelle du XIIe s. a pratiquement disparu) et de statues dont un grand Bouddha couché monolithique.
Les
deux autres grottes aménagées plus tardivement sont d'un moindre
intérêt. Leurs peintures sont assez mal restaurées (début
du XXe s.) et malgré cette restauration récente sont passablement
dégradées.
![]() Retour à Sigiriya (20 km environ)
et, pour ceux qui ont demandé à Sina de l'organiser, promenade à
dos d'éléphants (de 4 à 6 personnes par nacelle).
Retour à Sigiriya (20 km environ)
et, pour ceux qui ont demandé à Sina de l'organiser, promenade à
dos d'éléphants (de 4 à 6 personnes par nacelle).
![]() Dîner
Dîner
![]() Nuit à
l'hôtel.
Nuit à
l'hôtel.