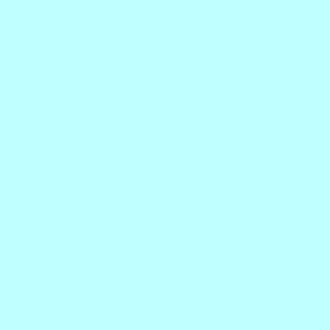
| |||
|
![]() Nous quittons Fès en autocar, avec le même groupe qui nous accompagnait
la veille dans la visite de Fès.
Nous quittons Fès en autocar, avec le même groupe qui nous accompagnait
la veille dans la visite de Fès.
Le programme du jour: visites
de Meknès et de Volubilis.
Après une accalmie, on peut constater
que police et gendarmerie ont repris leurs contrôles par les nombreux barrages
que nous franchissons sans être arrêtés. Des menaces terroristes
doivent encore planer et, n'oublions pas que les élections législatives
sont proches (9 septembre)...
Nous avons de nouveaux aperçus sur
la plaine du Saïss, autrefois occupée par un grand lac et qui doit
sa fertilité actuelle à la proximité des montagnes du Moyen
Atlas et aux barrages qui ont été construits et qui jouent le rôle
de châteaux d'eau.
De place en place, on traverse des oliveraies et
le guide nous fait observer que les oliviers marocains ont plusieurs branches
partant du sol à la différence des oliviers d'Andalousie dont les
branches partent d'un tronc. Bien évidemment, tout chauvinisme mis de côté,
l'huile d'olive marocaine serait bien meilleure (plus douce) que l'espagnole...
La récolte des olives a lieu d'octobre à janvier, selon les variétés
et le degré de maturité recherché (qui dépend de l'usage
auquel on destine la récolte).
Jusqu'en 1967, les Français ont
pu exploiter de grandes propriétés, notamment viticoles. Actuellement
de grandes tribus arabes exploitent collectivement des terres sans en être
propriétaires.
Meknès,
capitale berbère se situe à 520 m. d'altitude.
Meknès
est la plus grande ville de garnison (position centrale) et sa population d'origine
européenne vient en second pour son importance, après celle de Casablanca.
Pour les touristes, c'est une étape incontournable avec ses monuments majestueux.
La ville fondée au Xe s., fortifiée par les Almoravides,
reconstruite par les Almohades au XIIe s., fut agrandie par leurs successeurs
après l'éclipse des Mérinides.
C'est
la ville de Moulay Ismaïl, le second monarque de la dynastie alaouite qui
en fait sa capitale au détriment de Fès dont il craignait l'esprit
frondeur.
Meknès eut son heure de gloire lors
du règne de Moulay Ismaïl, ce "Louis XIV marocain". Il y
fit élever les remparts de 40 km de long, pilla les ruines de Volubilis
et le palais el-Badi de Marrakech pour construire sa cité impériale.
Il ne reste de ce palais, Dar el-Makhzen, que les immenses greniers à blé,
un lac artificiel et les écuries.
Certaines portes des remparts sont
de toute beauté. La médina abrite des médersas, des souks,
la place el-Hdim et ses galeries latérales.
C'était
un roi mégalomane, contemporain, admirateur et imitateur du Roi Soleil
qui voulait faire de sa ville un "Versailles marocain".
La ville
est protégée par trois enceintes, les plus longues atteignant 25 km
et 40 km!
 MEKNÈS
- panoramique sur la vieille ville
MEKNÈS
- panoramique sur la vieille ville
La
ville est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996
![]() .
.
| ||||
Après
avoir traversé la Meknès moderne, à l'est donc côté
Fès, nous dominons la vallée de l'Oued Boufekrane et faisons face
à l'ancienne ville avec sa médina.
La visite est guidée
par Djamila.
Nous longeons une enceinte dotée de très belles
portes, notamment Bab-el-Khémis ou Bab Lakhmiss ("porte
du jeudi") aux mosaïques vertes, près du mellah (ancien
quartier juif).
Arrivée sur la place El Hedim ou Lahdim (qui servi
d'entrepôt de matériaux pour les travaux pharaoniques de Moulay Ismaïl),
vaste esplanade reliant la médina et la ville impériale, avec ses
galeries latérales et ses kiosques.
![]()
Mais c'est surtout
la porte Bab el Mansour qui se trouve en bordure de cette place, à
l'opposé du musée Dar Jamaï, qui retient l'attention.
Ce
portail massif situé entre la vieille ville et la ville impériale
fut pour l'essentiel réalisé de 1672 à 1675. Il fut achevé
par le fils de Moulay Ismaïl en 1731 ou 1732. Cette porte en chicane (pour
éviter l'usage de béliers) atteint 16 m. de haut et comporte
deux salles dans ses annexes. Un magnifique réseau d'entrelacs en relief
se détache sur fond de mosaïque verte.
Elle doit son nom à
son architecte, un renégat chrétien Mansour el Aleuj.
![]() La visite se poursuit à la périphérie de l'ancienne ville
impériale dans le quartier de l'Agdal (ou Sahrij Souani) avec un bassin
de 4 ha (alimenté par des canalisations de 15 km depuis le Moyen
Atlas), tout proche du Dar el Ma, "la maison de l'eau".
La visite se poursuit à la périphérie de l'ancienne ville
impériale dans le quartier de l'Agdal (ou Sahrij Souani) avec un bassin
de 4 ha (alimenté par des canalisations de 15 km depuis le Moyen
Atlas), tout proche du Dar el Ma, "la maison de l'eau".



MEKNÈS - Dar el Ma ("maison
de l'eau")
| ||||
Cet
étrange édifice aux pièces sombres dont les voûtes
s'élèvent à 16 m. au-dessus du sol, abritait des citernes
enterrées (40 m. de profondeur) et servait de lieu pour stocker bien
au frais (murs de 4 m. d'épaisseur) des quantités de denrées
(céréales et fourrages) dans l'éventualité de longs
sièges car il fallait assurer la subsistance de la population, de l'armée
et, évidemment, du palais et de la Cour (et de 600 concubines?!).
Ces
greniers bien restaurés voisinent avec les ruines des écuries qui
abritaient 12000 chevaux et couvraient 4 ha (à noter que, non loin
de la ville, de grands haras furent créés en 1912). Les 4000 piliers
massifs subsistent tandis que les plafonds se sont écroulés lors
du tremblement de terre de Lisbonne (1755). Malheureusement, les intempéries
et la végétation attaquent les arcades subsistantes (en terre et
chaux). Dommage car les vestiges sont impressionnants et présentent de
belles perspectives droites et obliques.
On dit que 60000 esclaves et
prisonniers (chrétiens surtout) auraient travaillé pendant 20 ans
à l'édification de l'ensemble.
Notre courte découverte
de Meknès se termine par la visite du Mausolée de Moulay Ismaïl
(ou Ismael). L'entrée est libre mais on doit se déchausser bien
que l'on n'ait pas accès à la partie principale où se trouvent
son tombeau, celui de son épouse et de ses deux fils. Les horloges comtoises
que l'on voit seraient des cadeaux offerts par Louis XIV pour atténuer
l'affront de son refus de lui accorder la main de sa fille légitimée
(qu'il eut avec Mme de la Vallière), la future princesse de Conti.
![]()
![]() Tout près de là,
notre matinée de visite se termine dans un atelier-boutique de damasquinage.
Tout près de là,
notre matinée de visite se termine dans un atelier-boutique de damasquinage.
Le damasquinage...
C'est une technique d'orfèvrerie consistant à réaliser des décors par incrustation dans les sillons ou ciselures gravés sur un métal plus banal (fer, acier) de filets de métaux précieux, fils d'or jaune ou d'argent (ou de cuivre... attention à la tromperie!), à l'aide d'un poiçon et d'un marteau léger à panne large. Souvent en forme d'arabesques, ces dessins ainsi formés ressortent alors par contraste de couleurs. Ceci nécessite plusieurs cuissons du métal et polissages. L'assemblage de plaques de métal formé par martelage permet d'obtenir des objets de grand volume.
La technique fut utilisée pour la décoration ou la signature d'armes (épées, fusils) avant de l'être en joaillerie ou sur des objets purement décoratifs, comme on en voit ici. Technique orientale comme son nom l'indique (Damas en Syrie), c'est pourtant aujourd'hui une spécialité de Tolède en Espagne. Comme à propos du maillechort, il y a encore débat ici sur cette origine. La technique aurait été (re)découverte ou affinée par l'espagnol Eusebio de Zuloaga (de Eira) .
La boutique vend aussi des ouvrages brodés qui, paraît-ils seraient
réalisés par des religieuse françaises...
![]() Nous
quittons la médina en passant près de l'ancien quartier des potiers
établit dans la vallée qui sépare de la ville nouvelle. C'est
dans la partie boisée de cette vallée que nous allons déjeuner,
dans le magnifique restaurant "Zitouna" (ancien fondouk, autrement
dit une ancienne hôtellerie ou caravansérail sur plusieurs niveaux,
les étages servant de logements).
Nous
quittons la médina en passant près de l'ancien quartier des potiers
établit dans la vallée qui sépare de la ville nouvelle. C'est
dans la partie boisée de cette vallée que nous allons déjeuner,
dans le magnifique restaurant "Zitouna" (ancien fondouk, autrement
dit une ancienne hôtellerie ou caravansérail sur plusieurs niveaux,
les étages servant de logements).
En quittant le restaurant, on
passe devant les panneaux électoraux (comme les prospectus, ils sont essentiellement
écrits en arabe). Le Maroc est connu pour héberger beaucoup des
fameux centres d'appels. Ici, un établissement de formation à ces
métiers en témoigne...
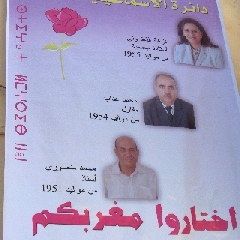
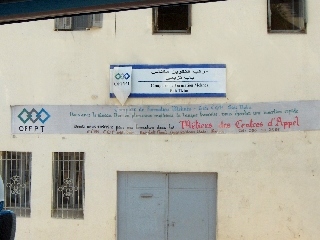
MEKNÈS - d'autres aperçus
sur la vie ici...
![]() Une vingtaine de kilomètres nous séparent de Volubilis.
Une vingtaine de kilomètres nous séparent de Volubilis.
A 5 km
du site antique, nous passons près de la ville sainte de Moulay Idriss.
Rien à voir avec Moulay Ismaïl car presque un millénaire sépare
ces deux souverains du pays. La petite ville blanche perchée sur une colline
abrite le mausolée du fondateur arabe (descendant de Fatima, la fille du
prophète) de la première dynastie marocaine. Les non musulmans ne
sont pas très appréciés dans cette ville et ce, d'autant
qu'un grand pèlerinage à lieu tous les ans fin août.
Par
ailleurs la petite ville s'anime le samedi, jour du marché rural.



Moulay Idriss et VOLUBILIS (capitole et basilique)
![]() Sur une petite éminence, proche de la ville de Moulay Idriss (ou Moulay
Driss Zarhoun), au milieu d'une plaine de cultures et d'oliveraies aux enclos
protégées par des agaves, figuiers de barbarie et eucalyptus, émergent
les vestiges romantiques d'un site antique où les cigognes viennent nicher
au sommet des colonnes. C'est la plus vieille cité du Maroc dont les vestiges
nous sont parvenus dans le meilleur état.
Sur une petite éminence, proche de la ville de Moulay Idriss (ou Moulay
Driss Zarhoun), au milieu d'une plaine de cultures et d'oliveraies aux enclos
protégées par des agaves, figuiers de barbarie et eucalyptus, émergent
les vestiges romantiques d'un site antique où les cigognes viennent nicher
au sommet des colonnes. C'est la plus vieille cité du Maroc dont les vestiges
nous sont parvenus dans le meilleur état.
Le site de Volubilis
fut habité du Ier s. avant J-C jusqu'à la fin du IIIe s.
Ce fut la capitale de Juba II, roi de Maurétanie au début de
l'ère chrétienne avant que la région soit directement rattachée
à l'Empire Romain au milieu du Ier s.. Après le déclin
de Rome, le site fut occupé par des Berbères christianisés
et leur servit aussi de carrière. Le site n'aurait été complètement
abandonné qu'au XIIe s.
Le site antique de Volubilis, pillé
par Moulay Ismaïl au XVIIe s., avait été repéré
par un britannique en 1721, avant d'être encore davantage ruiné par
le tremblement de terre de Lisbonne de 1755. Les Français entamèrent
des fouilles à partir de 1915 et certains éléments du site
furent remis en place en 1933. Le site est inscrit au Patrimoine Mondial de l'Unesco
depuis 1997, ce qui se justifie par la beauté du site et l'ampleur des
ruines: maison d'Orphée, maison de l'Ephèbe, Arc de Triomphe de
Caracalla (remonté en 1933), l'avenue decumanus maximus...
| ||||
Les
archéologues attendent des aides de l'Unesco pour poursuivre les
fouilles car seule une partie du site de 40 ha a été explorée.
![]() Sous un soleil brûlant,
dans un site pratiquement sans ombrage, nous entreprenons la visite en compagnie
de notre guide Abdoul. Après avoir franchi le vallon de l'oued Fertassa,
nous gagnons le coeur de la cité, le forum. Les colonnes du temple du Capitole
sont l'élément le plus voyant du site. Tout près (au nord)
se dressent les arcades bien restaurées d'une basilique à trois
nefs (de 80m de long) qui servait de bourse et de lieu couvert pour se réunir.
Sous un soleil brûlant,
dans un site pratiquement sans ombrage, nous entreprenons la visite en compagnie
de notre guide Abdoul. Après avoir franchi le vallon de l'oued Fertassa,
nous gagnons le coeur de la cité, le forum. Les colonnes du temple du Capitole
sont l'élément le plus voyant du site. Tout près (au nord)
se dressent les arcades bien restaurées d'une basilique à trois
nefs (de 80m de long) qui servait de bourse et de lieu couvert pour se réunir.
Petit détour pour expliquer que Volubilis tirait sa richesse de l'olive.
Dans une construction, on nous présente une huilerie avec meule et pressoir
à olives.
Maintenant, admirons la mosaïque qui ornait le
centre de la pièce principale de la Maison d'Orphée: on y
voit Orphée tenant toute une ménagerie (lionne, éléphant...)
sous le charme de son chant. Il s'agit bien là de mosaïques antiques
faites de fines tesselles taillées dans des roches naturellement colorées
, ce qui n'a rien à voir avec les mosaïques arabo-berbères
faites à partir de zelliges, morceaux taillés dans diverses céramiques.
Nous remontons vers le haut du site en passant par la Maison au Desultor
où une mosaïque présente un acrobate chevauchant un âne
à l'envers. Puis nous arrivons à l'Arc de Triomphe qui s'inscrivait
dans la perspective de la large avenue Decumanus Maximus. Il fut édifié
en 217 en l'honneur de Caracalla et dû être totalement remonté
en 1933.
La Maison aux Colonnes est intéressante par ses
colonnes torses et par l'originalité de son bassin, l'impluvium,
de forme circulaire. La Maison au Cavalier qui fait suite possède
une belle mosaïque représentant Bacchus surprenant Ariane endormie
sur la plage de Naxos...


VOLUBILIS
- la Maison aux Colonnes et la Maison au Cavalier (Bacchus et Ariane)


VOLUBILIS - mosaïques
de la Maison aux Travaux d' Hercule et de la Maison de Dionysos
En suivant l'avenue centrale, on peut encore admirer les mosaïques de la
Maison aux 12 Travaux d'Hercule (Hercule et les deux serpents, Hercule
et le lion) avec le svastika ou croix gammée (vieux symbole panthéiste
et porte-bonheur utilisé par tous les peuples de l'Eurasie et détourné
par les nazis au siècle dernier) puis celles de la Maison de Dionysos (les
quatre saisons) et celle de la Maison du Bain des Nymphes...
La visite se
termine par le Palais de Gordien et la Maison du Cortège de Vénus...
![]() MOSAÏQUES
MOSAÏQUES
La
mosaïque est un art décoratif où l'on utilise des fragments
de pierre, d'émail, de verre ou encore de céramique, assemblés
à l'aide de mastic ou d'enduit, pour former des motifs ou des figures.
Quel que soit le matériau utilisé, ces fragments sont appelés
des tesselles.
La
mosaïque antique, romaine, était faite de pierre et de marbre. Par
la suite, la mosaïque byzantine, puis vénitienne utilise des émaux
et pâtes de verre (y compris recouverte d'or). Enfin, la mosaïque arabe
a subi l'influence antique et byzantine (mosaïque à fond d'or), on
y rencontre une mosaïque de céramique assez spécifique à
l'art timuride.
![]() Retour à Fès sans revenir par Meknès. Après le passage
du Col du Zagotta, nous retrouvons la route venant du nord par laquelle nous arrivions
à Fès deux jours plus tôt... Paysage toujours aussi étonnant
vu à la chaude lumière d'une fin d'après-midi.
Retour à Fès sans revenir par Meknès. Après le passage
du Col du Zagotta, nous retrouvons la route venant du nord par laquelle nous arrivions
à Fès deux jours plus tôt... Paysage toujours aussi étonnant
vu à la chaude lumière d'une fin d'après-midi.
| ||||
MAROC