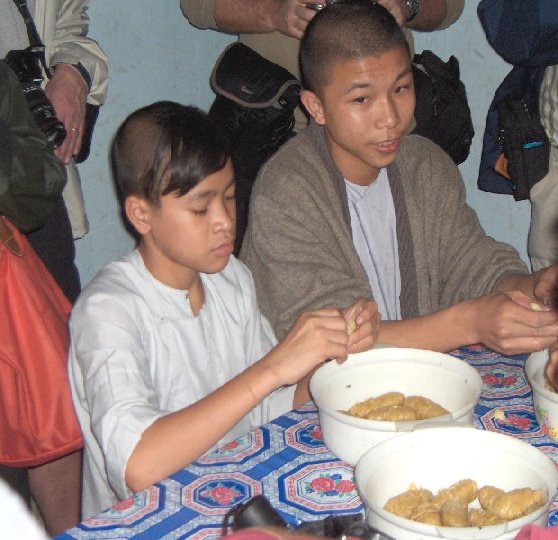Col des nuages (1),
Hué
(citadelle, cité) (2),
Rivière des Parfums (3)
et
Tombeaux des empereurs (4) | | |
|
| | |


ET
LES NOM DE PERSONNES ?
autre similitude avec la Chine...
Il n’y a que 140 noms de famille en usage au Vietnam (d'autres
sources disent 300 mais cela reste quand même minime).
En fait, plus que
de marquer l’appartenance à une lignée, ils marquent un lien à un ancien souverain
du pays pour la trentaine de noms vraiment vietnamiens: Dinh, Ly, Lê, Tran,
Ngyuen (ces derniers sont les plus récents et les plus nombreux)…
Les
autres sont d’origine chinoise, cambodgienne ou d’ethnies minoritaires.
Le nom complet d'une personne comporte généralement trois parties.
En premier le nom patronymiques (ho).
Il est suivi du nom intercalaire ou nom-tampon (tên dêm) utilisé seulement
dans les documents officiels. Vient enfin le nom propre
servant de prénom (tên) qui est porteur de sens dans la langue courante.
Les noms des femmes évoquent souvent des fleurs (par ex. "Lan" signifie
"Orchidée", "Phuong" signifie "Flamboyant"...). Contrairement
à l'usage dominant chez nous, ici l'énonciation de l'identité se fait sous la
forme "nom+prénom".
Et on appelle les gens par leur prénom précédé de la
civilité appropriée ("Mademoiselle Orchidée").
|
|
|
|
| Dans
la région de Hoi An - Danang... |
Pour gagner HUÉ,
il faut remonter vers le nord, en repassant à Danang puis emprunter la pittoresque
route du Col des Nuages dont le parcours longe souvent l'unique voie ferrée
qui relie Saigon à Hanoi (legs des Français) à la vitesse moyenne de 36km/h (!,
selon la gamme de train emprunté, la durée du trajet varie de 68 à 30 heures...).
Notre bus lui aussi peine sur cet itinéraire en mettant trois heures pour
parcourir les 110 km séparant Danang de Hué!
Nous revoyons les
nombreux ateliers de sculpteurs de statues de Bouddha, de gardiens grimaçants
et d'animaux fantastiques (dragons et autres licornes) ainsi que des marbriers
qui taillent des stèles ou des tombeaux. Il est vrai que nous sommes tout près
des fameuses Montagnes de Marbre d'où est tirée la matière première.
En
Cochinchine, autrement dit au sud Vietnam, on était dans l'aire d'influence du
bouddhisme Hinayana
dit du " Petit Véhicule", proche de l’une
des plus anciennes écoles bouddhiques, l'école Theravada ("la
voie des anciens") diffusé à partir de Ceylan dans l'Asie
du sud-est. Les morts y sont incinérés.
En revanche à partir
d'ici, c'est-à-dire de l'Annam, autrement dit au nord du Vietnam,
le bouddhisme est celui du "Grand Véhicule" (ou Mahayana).
Cette école est apparue dès le IVe s. av. J-C. et s'est diffusée
à partir de la Chine. Ici, le rite funéraire est celui de l'inhumation
et même de la double inhumation (dont on reparlera).
Dans la campagne s'étendent des zones de cultures inondées (riz, liseron d'eau)
et de maraîchage alors que du coté de Dannang, des Vietnamiens tirent une senne
sur le rivage mais la pêche est médiocre.
C'est aussi l'occasion d'observer de plus près le style des nouvelles maisons
vietnamiennes en parpaing, brique ou béton. Cette nouvelle architecture
se répand dans tout le pays, du Mékong au Tonkin.
Seule l'emprise au
sol reste traditionnelle, c'est-à-dire conditionnée par l'étroitesse du parcellaire
donnant sur la rue, souvent moins de 5 m (comme dans les rizières).
Autrefois, lorsque les gens en avaient les moyens, ils étendaient
leur maison en profondeur (vers l'arrière). Aujourd'hui, ils construisent en hauteur
avec parfois 2 ou 3 étages, ce qui donne aux maisons une allure dégingandée. Les
façades sont parfois tarabiscotées (terrasses et balcons galbés, garde-corps en
inox ou au moins en acier chromé...) et colorées alors que les murs latéraux sont laissés en ciment voire
sont aveugles (puisque le voisin risque de construire à son tour).
Dans les
maisons les plus modestes, l'espace est restreint. La pièce à vivre (salle à manger,
salon) est au rez-de-chaussée et est largement ouverte vers la rue (on y voit
les gens vivre et ils y garent même leur moto!).
Il faut se souvenir que
si les conditions de vie et les techniques de construction ont évolué, la famille
vietnamienne reste constituée de 3 voire 4 générations qui cohabitent.
Les
plus riches achètent parfois la parcelle voisine, ce qui permet d'avoir une maison
de "proportion plus classique" et dont l'organisation doit être plus rationnelle
(disposition des ouvertures...).
Quant aux maisons basses et modestes de
petits paysans, elles voisinent souvent avec une meule de paille de riz de la
récolte précédente, un jardinet bien entretenu et une mare à canards.

| 
| 
| | Maisons de la région
de Hoi An - Danang. | | | |
|
| | |
|
| Dans de la région
de Hoi An - Danang. |
Cette
région semble moins riche au niveau des moyens de transport. On y voit davantage
de vélos, de vieilles motos, des camions vétustes de style soviétique (marque
IFA) et des engins assez indescriptibles, de même origine, tenant du tracteur
et de la camionnette (avec un moteur monocylindre). Les pompes pour le ravitaillement
en carburant y sont parfaitement assorties. En certains endroits (franchissement
de rivière), la route se rétrécit sur les ponts en ne laissant le passage qu'à
une voie.
Après avoir franchi le modeste col des Nuages (à peine
500 m d'altitude) qui mérite tout à fait son nom, le regard profite de quelques
échappées sur la péninsule de Lan Co au travers des nuages bas. Des ex-votos jalonnent
les virages les plus dangereux en témoignages d'accidents évités ou non (hormis
le style, cela rappelle un autre peuple religieux, celui de Grèce). Pour rester
dans un thème plutôt sinistre, à l'image d'un ciel bien gris, le long de la route
s'égrainent des cimetières traditionnels et des cimetières militaires récents
(guerre du Vietnam). Par
la présence d'églises, parfois modernes, on se rend aussi tout à fait compte que
les catholiques constituent une importante minorité religieuse dans le pays (20%
?).

| 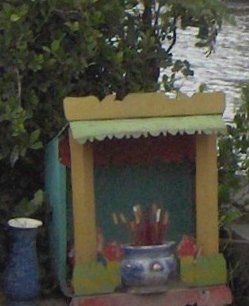
| 
| | Ex-voto. | Cimetière
militaire. |
Route du Col des Nuages (en direction de Hué). |

| 
| | | | | Une
église moderne. | Cimetière
traditionnel. | | |
|
|
| | |

La ville de HUÉ
n'allait pas faillir à sa réputation! Il y pleut souvent... tellement que même
la literie de notre hôtel, par ailleurs tout à fait correct, en sentait le moisi!
HUÉ, la ville à la couleur violette, symbole de la mélancolie...
La ville est connue par sa position stratégique.
Son choix tardif comme capitale de l'empire vietnamien peut surprendre en raison
d'un climat aussi peu favorable, même si le lieu a la faveur des géomanciens et
astrologues (proximité d'influence yang (montagne) et yin (mer).
Y ont surement contribué des considérations stratégiques: éloignement physique
et symbolique de la menace chinoise, position centrale dans un empire enfin unifié
qui s'étend sur près de 2000 km et rapprochement du fief d'où sont originaires
les princes Ngyuen..
Toujours stratégique au milieu du XXe s. puisque
ville située à 80 km au sud du 17° parallèle qui marquait la limite entre
les deux Vietnam après la partition de 1956 et donc la ligne où se concentrait
les hostilités lors de la guerre avec les Américains.
Lors
de l'offensive du Têt en 1968 (fête du Nouvel An lunaire dont la date varie
selon les années, entre la fin de janvier et la mi-février), les Viets Congs s'étaient
infiltrés dans la ville. A la suite des affrontements terrestres mais surtout
des bombardements, la vieille cité a été gravement endommagée puisque 42 des
67 édifices se trouvant dans le périmètre de la Citadelle ont été détruits.
Il faut préciser que près de 15000 personnes périrent lors de ces évènements.
La ville de Hué créée par les Chinois au IIIe s., devint la
Cité du Royaume des Chams du IVe s. jusqu'à la conquête par le Dai Viet
au XVe s. avec la dynastie des Lê postérieurs. Plus tard, lorsque le Vietnam
fut complètement unifié, elle devint capitale impériale de la dynastie des
Nguyen, de 1802 à 1945, à la place de Thang Long (Hanoi). Cette cité chère
reste au cœur des lettrés vietnamiens.
La Citadelle fût construite
entre 1805 et 1832 avec l'aide des Français. Ses fortifications rappellent les
travaux de Vauban. L'enceinte carrée, percée de quatre portes mesure 10 km.
A l'intérieur de la citadelle, la Cité Impériale est construite
sur le modèle des palais impériaux chinois et s'étend sur 530 ha, avec
une succession de pavillons et de cours, allant de plus en plus vers la sphère
privée du sud vers le nord.
Il faut préciser qu'une partie des monuments
"impériaux" de Hué proviennent de l'ancienne Cité Impériale d'Hanoi qui fut
démantelée
au XIXe s. par les souverains de la dynastie des Nguyen lorsqu'ils décidèrent
de déplacer la capitale du pays vers leur terre d'origine.
Les
"petits empereurs vietnamiens" de l'époque coloniale française
ne se sont pas bornés à rebâtir ici leur ancienne cité
de Hanoï mais ils ont voulu s'inspirer de la Chine des Ming avec toutefois
un facteur d'échelle en réduction. On retrouve donc dans la Cité
Impériale et la Cité Interdite de Hué une partie des concepts
de la Cité Interdite de Pékin
Dans la citadelle d'origine
coloniale,
s'élève la Cité Impériale (Hoang Thanh) que protège
une autre enceinte, de couleur jaune (couleur impériale
comme à la cour des Ming et des Qing en Chine)
percée de quatre portes orientées en direction des points cardinaux,
avec un axe majeur sud-nord conformément à la tradition chinoise
du fengshui. La porte principale réservée à l'empereur,
celle du Midi, est surmontée d'un belvédère couvert de tuiles
vernissées jaune (toujours la symbolique impériale). Elle débouche
sur le Pont de la Voie Céleste enjambant la rivière aux Eaux Dorées
(cf. Pékin) que l'on franchit pour arriver sur l'Esplanade des Grandes
Salutations sur laquelle s'élève le Palais de la Paix Suprême
(Dien Thai Hoa),
la salle du trône. Là encore
"copier/coller" avec le Palais de l'Harmonie Suprême de Pékin!
Par
contre, la Cité Pourpre Interdite (Tu Cam Thanh) de Hué, protégée
par une nouvelle enceinte (4m de haut et autant d'épaisseur) est située
au centre de la Cité Impériale
et correspond à la partie la plus privée alors qu'à Pékin,
le tiers nord de la Cité Pourpre
Interdite est réservé
à la partie privée (à laquelle les empereurs chinois accédaient
par la Porte
de la Pureté Céleste).
Ici, les empereurs Ngyuen entraient dans le Cité Pourpre
Interdite (toujours une couleur
impériale comme en Chine) par la porte sud dite Porte de la Grande Résidence.
Déclarée patrimoine historique par l’UNESCO depuis 1993  ,
Hué bénéficie d'importants travaux de restauration. Il faut encore éliminer quelques
700 constructions illégales implantées à l'intérieur de la Citadelle. Malgré tout,
elle offre à son visiteur de nombreux monuments d'un grand intérêt historiques
épargnés ou bien restaurés.
,
Hué bénéficie d'importants travaux de restauration. Il faut encore éliminer quelques
700 constructions illégales implantées à l'intérieur de la Citadelle. Malgré tout,
elle offre à son visiteur de nombreux monuments d'un grand intérêt historiques
épargnés ou bien restaurés.
La Tour du Drapeau ou du Chevalier,
bastion qui fait partie du système de défense de la Citadelle est le premier monument
qui s'impose à la vue en venant du sud . Pour entrer dans la Cité Impériale, il
faut donc franchir la porte sud (Ngô Môn) en granit, surmontée du
Belvédère des 5 Phénix d'où l'empereur se montrait à ses sujets. Après les douves,
s'étend l'Esplanade des Grandes Salutations qui précède le Palais de la Paix Suprême
(l'empereur y recevait les diplomates). Cette salle du trône est le seul
édifice qui ne fut pas endommagé lors des bombardements de 1968.
Nous
poursuivons la visite par le Temple dynastique des Nguyen (The Mieu où
l'on vénère 10 des 12 souverains Ngyuen), le Pavillon de la Splendeur (Hien
Lam Cac) devant lequel se dressent neuf urnes dynastiques pesant en moyenne
plus de 2 T (!).
Enfin, s'étendait sur 9 ha la Cité Pourpre
Interdite (Tu Cam Than) où vivaient l'empereur, les concubines et tous
les serviteurs. Il en reste peu de chose à la suite des destructions de 1968 qui
ont particulièrement affecté ce secteur. Nous pouvons cependant
en admirer la porte sud dite de la Grande Résidence (Dai Cung Mon)
ainsi que le Théâtre où se déroule la répétition d'un spectacle. Le rouge
des murs (symbole du feu) et le jaune des tuiles vernissées (symbole de
la terre) sont des couleurs réservées au pouvoir impérial
comme en Chine).
|

| 
| | | Tour
du drapeau ou du Chevalier.
| Douves
et porte sud de la Citadelle.
| |

| 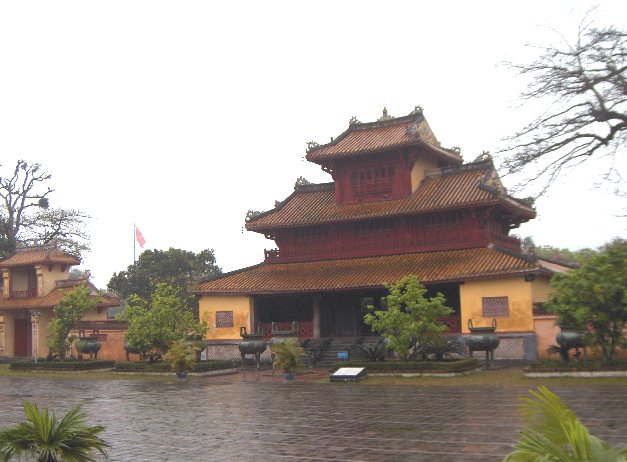
| 
| 
| | Porte sud Ngô Môn de la Cité
Impériale | Pavillon de la Splendeur. | Porte
de la Grande Résidence (Cité Interdite). | Le
théâtre. | | HUÉ:
Citadelle, Cité Impériale et Cité Pourpre Interdite. |
| | |
|
| | |

Le lendemain,
le temps nous est plus favorable puisque la pluie a cédé la place à un temps gris.
La promenade en bateau sur la Rivière des Parfums (Sông Huong)
est très agréable et, au fil de l'eau, permet de capter quelques éléments de la
vie des gens qui vivent du fleuve et sur le fleuve, dans leurs barques et leur
sampans (bateaux non pontés contrairement aux jonques, plus importantes). Nous
les voyons aussi draguer des granulats et sables dont ils chargent leur sampan
ou leur barge à ras bord.
|
| |
| HUÉ,
sur la Rivière des Parfums... |
Le bateau
nous dépose au pied de l'escalier qui monte vers la Pagode de la Vieille Dame
Céleste (Thien Mu comme en chinois "TIAN" pour désigner le "ciel")
édifiée en 1601 par un seigneur Nguyen (maître de l'Annam et de la Cochinchine
et dont les descendants fondront plus tard la dernière dynastie vietnamienne)
et agrandie un siècle plus tard.
Selon la légende, une vieille dame
vêtue d'une tunique rouge et d'un pantalon vert, brandissant une lanterne, était
apparue promettant la prospérité à celui qui construirait une pagode en ce lieu
propice du fait de la convergence de forces bénéfiques (yang=colline et
yin=rivière).
La tour octogonale édifiée en
1844 par l'empereur Thieu Tri est haute de 21 m et comporte 7 niveaux, chacun
symbolisant une réincarnation de Bouddha (ou les 7 années pendant lesquelles il
a cherché à atteindre l'''Eveil''). A proximité se trouve une cloche de 2 T
(mesurant 2 m de haut) que l'on peut entendre jusqu'à 15 km! Elle date
de 1710. Dans l'enceinte du monastère, la Pagode Dai Hung honore 4 Bouddha:
au premier plan, un Bouddha Souriant et à l'arrière-plan Amitabha, Sakayamuni
et Maitreya ...des Bouddha dotés d'auréoles lumineuses sophistiquées à effet
de scintillement (comme nous en avons déjà vu du côté de Mytho).
La
visite se poursuit par les locaux conventuels. De jeunes bonzes y préparent des
nems. Plus loin, on peut voir la voiture (Austin) qu'utilisa le bonze Thic
Quang Duc pour se rendre à Saigon où il s'immola par le feu sous les yeux
des reporters de la presse internationale en 1963. Son geste était une forme de
protestation extrême contre les persécutions qu'exerçait Ngô Dinh Diêm,
le président du Sud-Vietnam, catholique et pro-américain, à l'encontre des moines
qu'il soupçonnait d'héberger des rebelles Viet Cong. Après lui, de nombreux autres
bonzes se sacrifièrent de la même manière.

| HUÉ,
la Pagode de la Vieille
Dame Céleste... | 
| La tour octogonale à 7 niveaux
(Thap Phuoc Dyen).
| | La cloche
de 2 tonnes.
| 
| 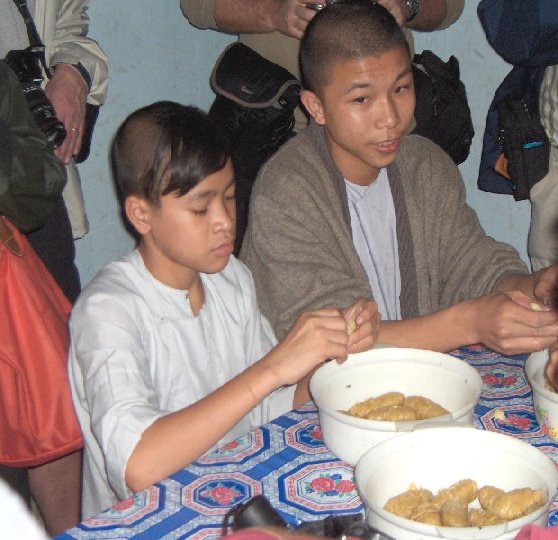
| 
| | | Voiture
de Thic Quang Duc qui s'immola par le feu en 1963
| | | Les
4 Bouddha de la Pagode Dai Hung.
| Jeunes
bonzes préparant des nems. | (Passez
la souris sur l'image ci-dessus.) | | |
| |
| | |
De retour à Hué, promenade libre dans le marché régional
Dong Ba, situé au bord du fleuve.
Ce marché peu fréquenté
par les touristes est très pittoresque. La proximité de la gare routière permet
aux villageois des environs de s'y rendre facilement. On y trouve viandes, fruits
et légumes (meules de manioc, tofu de soja), articles de quincaillerie, vêtements,
montres et bijoux, fleurs naturelles et artificielles (couronnes mortuaires notamment
sachant que les fleurs naturelles sont préférées car moins souvent volées ...puisqu'elle
ne durent pas).
Les chapeaux coniques qu'on y voit aussi sont considérés
comme les plus beaux du pays. Ce chapeau symbole du Vietnam est réalisé sur une
forme conique avec des feuille de lantanier (sorte de palmier buissonnant) fixées
sur une légère armature faite de lanières tirées de la tige du bambou et disposées
de place en place, en cercles de taille décroissante.

L'après-midi
est consacré à la visite des mausolées et tombeaux de deux empereurs de la dynastie
Nguyen (il serait plus juste de parler de rois car ils s'étaient placés sous
la "protection" de la France voire n'avaient plus de pouvoir dans le cadre de
la colonie d'Indochine).
Ces monuments se trouvent à une dizaine de kilomètres
au sud de Hué dans une région de collines très verdoyantes dont les sous-bois
tapissés de fougères témoignent du climat de la région ...à l'origine d'un vieillissement
accéléré (et dangereux) des monuments.
Le tombeau de Kai Dinh,
12e et avant-dernier souverain Nguyen (règne
de 1916 à 1925), se trouve au village de Chau Chu. La nécropole que les
guides touristiques qualifient de très kitsch a été construite de 1920 à 1931
sur un site de colline en terrasse. Le souverain mort en 1925 avait fait réaliser
en France sa statue en grandeur réelle.
Les constructions sont en béton armé
mais on a peine à le croire tant l'outrage du temps (météo) a appliqué une patine
noirâtre à l'ensemble. Après avoir gravi l'escalier monumental de 148 marches
et franchi la grille, on accède au pavillon octogonal de la Stèle que lui dédia
son fils adoptif, Bao Dai, le dernier "souverain fantoche" vietnamien (lequel
après avoir remis son pouvoir entre les mains du Viet-minh en 1954 fut trahi par
le premier ministre du Sud-Vietnam qui le destitua en 1955. Bao Dai dut s'exiler
en France et il est mort à Paris en 1997. Ce pavillon est au centre de
la Cour d'Honneur gardée par des statues de guerriers et de mandarins (accompagnés
de chevaux et d'éléphants). Puis, après un autre escalier, on arrive au Temple
du Culte (Thieu Dinh) qui a subi un ravalement et dont l'intérieur est
décoré de fresques en mosaïque constituées de tesselles de porcelaine et de verre
incrustées dans du ciment. Ce mélange d'influences européennes et orientales,
taoistes et géométriques, est du plus curieux effet...

| 
| 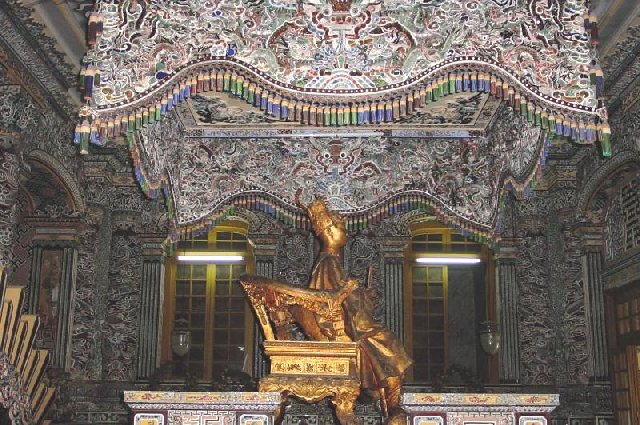
| 
| HUÉ, tombeau de KHAI
DINH.
| Cour
d'Honneur.
| Temple du culte Thieu
Dinh (extérieur).
| Temple du culte,
sous le dais (en béton),
statue de Khai Dinh sur son trône. | Temple
du culte, fresque en mosaïque.
|
| | 
| 
| | < | Pavillon de la
stèle érigé par Bao Dai, fils adoptif de Khai Dinh. | |
| |
|
| | |
A quelques kilomètres de là, le site suivant est très différent
et plus ancien. Il s'agit du Mausolée de Tu Duc, 4e
souverain (1848-1883) de la dynastie Nguyen. L'ensemble des constructions ont
été réalisées de 1864 à 1867 (le souverain est mort en 1883) par 3000 ouvriers
(!) sur les plans établis par l’empereur en personne. Lequel empereur se faisait
architecte mais était aussi poète à ses heures puisqu'il a écrit 1500 poèmes.
Ce Mausolée est une sorte de palais plutôt qu'un tombeau (d'ailleurs
Tu Duc ne serait pas inhumé sur le site même mais plutôt dans une pinède voisine
en un endroit inconnu puisqu'il semblerait que les quelques centaines d'ouvriers
qui auraient participé à la construction du tombeau eussent ensuite été exécutés!).
L'ensemble monumental se trouve au milieu d'un parc paysager planté de frangipaniers
et de pins, avec des pavillons d'agrément au bord d'un étang, le Pavillon de la
Modestie (il servit de résidence d'été avant d'être transformé en temple), théâtre...
Ce qui frappe en s'y promenant, c'est la dégradation des pavages extérieurs
et des murets dont les dentelles de brique se désagrègent.
Mais le
souci de conservation des monuments est bien un trait typique de notre culture
occidentale. Dans ces régions, seul le site "consacré" à de l'importance et l'on
remplace le monument vétuste par un nouveau lorsque cela s'avère nécessaire.

| 
| | HUÉ, mausolée de
TU DUC. | | | |
|
| | |
Retour à Hué, quelques kilomètres seulement. Atelier forain
de fabrique d'encens et toujours de surprises le long du trajet...
La soirée se termine en beauté par un dîner impérial costumé,
mandarins et mandarines entourant l'empereur et sa première dame...
L'empereur
est parfaitement reconnaissable au centre, avec son habit doré, couleur
impériale comme à la cour de Chine...
Nous sommes accompagnés
par un orchestre de musique traditionnelle comme c'est le cas dans au moins la
moitié des restaurants. On peut apprécier les flutes, percussions diverses, le
luth (dan nguyet), la cithare à 16 cordes (thap luc) et le monocorde
typiquement vietnamien (dan bau).
Quant au repas, ici à Hué comme
à Saigon d'ailleurs, le menu copieux qui comporte en général 7 petits plats est
agrémenté par des présentations sophistiquées où revient toujours le thème de
l'oiseau (sans doute pour compenser les mets de volailles qui sont bannis par
ces temps de grippe aviaire!)... des présentations que nous n'aurons plus dans
le nord.
Au terme de ces deux jours dans la région de
Hué, il faut être clair, malgré le climat humide de la région, malgré les destructions
de monuments dans la Cité de Hué (en lisant les publications sur le sujet, on
s'attend à voir un champ de ruines si ce n'est un champ de bataille) et malgré
la patine accélérée des tombeaux et mausolées des souverains, cette partie du
Vietnam mérite absolument la visite.
Le lendemain matin, lever
à 5 heures pour prendre l'avion qui nous conduira à Hanoi (une heure de vol pour
environ 500 km)...




VIETNAM

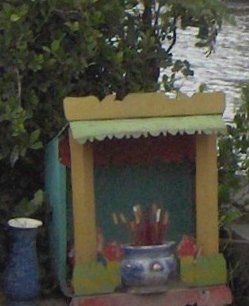



![]() ,
Hué bénéficie d'importants travaux de restauration. Il faut encore éliminer quelques
700 constructions illégales implantées à l'intérieur de la Citadelle. Malgré tout,
elle offre à son visiteur de nombreux monuments d'un grand intérêt historiques
épargnés ou bien restaurés.
,
Hué bénéficie d'importants travaux de restauration. Il faut encore éliminer quelques
700 constructions illégales implantées à l'intérieur de la Citadelle. Malgré tout,
elle offre à son visiteur de nombreux monuments d'un grand intérêt historiques
épargnés ou bien restaurés. 


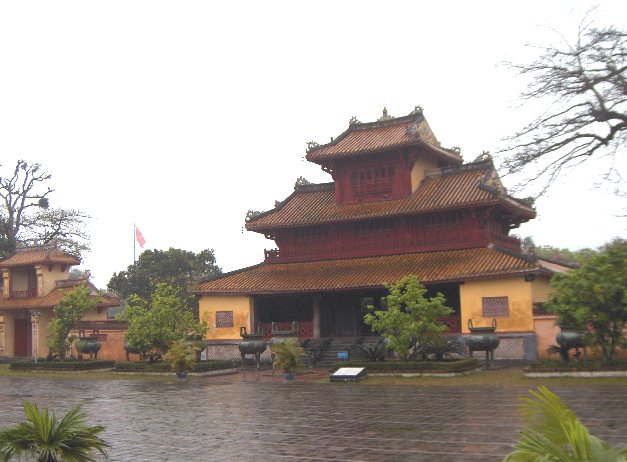


![]()