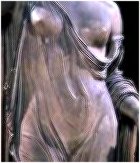Les
monuments se multiplient dans les grands sanctuaires de Grèce, mais également
en Grèce de l'Est, où l'Ionie développe une civilisation brillante, et dans les
colonies. L'art d'Athènes reflète un certain luxe.
Architecture
Les temples tendent à être réalisés entièrement en
pierre, y compris les colonnes lesquelles sont représentatives de divers ordres
ou styles architecturaux.
L'ordre dorique, né en Grèce, s'est répandu
partout. La colonne dorique, sans base, se termine par un chapiteau simple fait
d'un élément circulaire évasé, l'échine, et d'une dalle carrée, l'abaque.
Sur les colonnes repose l'entablement, composé dans l'ordre dorique d'une architrave
lisse et d'une frise où alternent des éléments à rainures, les triglyphes,
et des plaques presque carrées, les métopes, d'abord peintes, puis sculptées.
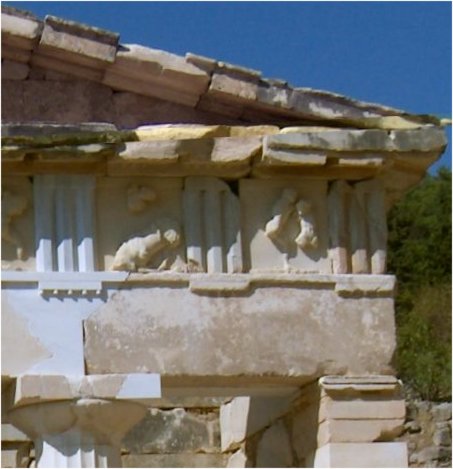
Le fût, légèrement renflé et plus large à la base (forme tronconique), porte
20 cannelures contiguës.
L'ordre ionique s'est épanoui en Grèce de l'Est,
mais s'est diffusé également au-delà, notamment à Athènes, où il par la suite
modifié à l'époque classique avec l'introduction du chapiteau corinthien, à feuilles
d'acanthe, plus décoratif et plus pratique grâce à ses quatre faces semblables.
La colonne ionique a une base formée de moulures variées et un chapiteau
comportant un motif dont les extrémités s'enroulent, formant des volutes sur les
deux faces principales, et sur les autres des cylindres, l'abaque est mince et
décoré. Le fût, aux proportions plus élancées que la colonne dorique, porte 24
cannelures ou plus, séparées par des bandes.
Sur l'architrave ionique, à
trois bandeaux, repose une frise lisse ou ornée d'une décoration en relief continue.
À la puissance et à la rigueur de l'ordre dorique, l'ordre ionique oppose légèreté,
richesse décorative et variété.
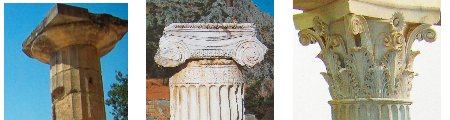
D'autres types de bâtiments deviennent fréquents, notamment les trésors,
élevés dans les sanctuaires pour abriter des offrandes et semblables à de petits
temples.
Sculpture
Deux types dominent : le kouros (jeune homme nu debout au repos) et la
koré (jeune fille drapée). Il s'agit d'images idéalisées offertes dans les
sanctuaires ou placées sur les tombes. Elles obéissent au principe de la frontalité
: leur axe vertical ne subit ni flexion, ni torsion. Jambe gauche avancée, bras
le long du corps et poings serrés.
Chez les Grecs, le culte de la nudité
totale était une conséquence de leur sens de la perfection humaine (être à l'état
des dieux), et possédait donc un aspect éthique, non seulement physique.
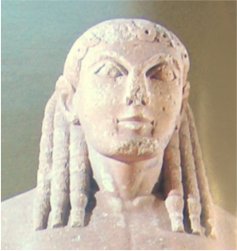
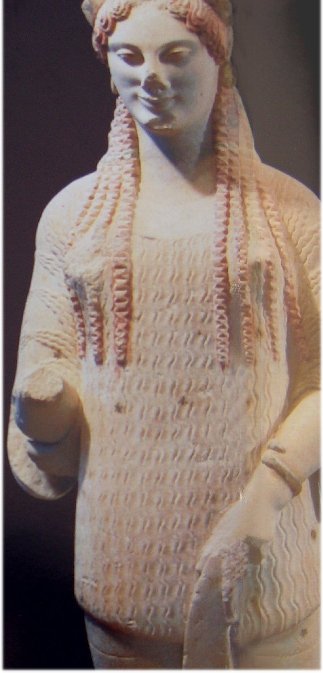 Le kouros, qui apparaît vers la fin du VIIe siècle, dérive de modèles égyptiens
mais la fabrication en série permet une maîtrise de la technique des sculpteurs
caractérisée par un meilleur rendu de l'anatomie.
Le kouros, qui apparaît vers la fin du VIIe siècle, dérive de modèles égyptiens
mais la fabrication en série permet une maîtrise de la technique des sculpteurs
caractérisée par un meilleur rendu de l'anatomie.
Les korés de l'Acropole
d'Athènes (-500) illustrent en majorité un type ionien qui s'est imposé aux dépens
de conceptions plus sobres. Le corps féminin intéresse moins les artistes que
les jeux de plis et les multiples détails de la parure.
De 575 à 500 av.
JC environ, kouros et korés arborent le "sourire archaïque" qui leur confère un
aspect animé et plaisant mais les oeuvre tardives apparaissent même maussades.
La sculpture en ronde-bosse comporte diverses illustrations comme
"le Moscophore", ou porteur de veau au rendu maladroit (v. 570, musée de
l'Acropole), des groupes équestres, des sphinx posés sur des colonnes ("Sphinx
des Naxiens" -570 à Delphes) ou couronnant des stèles et surtout des personnages
assis.
Par ailleurs, les principes de la sculpture architecturale se
mettent en place. Les frontons tendent vers l'unité du thème et de l'échelle et
font appel à la ronde-bosse (temple d'Apollon à Delphes).
Les métopes
des temples et des trésors doriques reçoivent un décor en relief témoignant de
la richesse inhérente à l'architecture ionique, avec ses caryatides en façade,
ses deux frontons sculptés et une frise continue traitant un thème par face ;
le côté le plus en vue étant plus travaillé.
Céramique
 Les vases attiques, appréciés pour leur forme et leur décor, prennent la place
de la céramique corinthienne qui dominait lors de la période précédente.
Les vases attiques, appréciés pour leur forme et leur décor, prennent la place
de la céramique corinthienne qui dominait lors de la période précédente.
Les peintres de vases athéniens adoptent la technique de la figure noire, dans
un premier temps, en peignant de grandes figures, puis en se portant vers la décoration
orientalisante où les scènes mythologiques sont toujours présentes. Par la suite,
les artistes s'inspirent der la vie quotidienne (l'ivresse dyonisiaque) et améliorent
le rendu des plis et des visages, parfois de face.
Vers 530 apparaît
la figure rouge sur fond noir, invention athénienne . La technique consiste
à réserver les figures en peignant le fond en noir. Les détails intérieurs sont
indiqués au pinceau à l'aide de vernis plus ou moins concentré. Les artistes représentent
des attitudes complexes, des détails anatomiques et s'efforcent de rendre le volume
par le dessin, mais aussi en ombrant de lavis des zones en retrait.
Retour
au MENU
PÉRIODE CLASSIQUE
(V. 480-323 AV. J.-C.)
La période classique,
de la fin des guerres médiques au règne d'Alexandre le Grand, correspond à la
maturité de l'art grec.
Période
préclassique ou sévère (480-450 av. J.-C.)
Après la victoire
des Grecs sur les Perses, la nécessité de remédier aux destructions provoque une
intense activité artistique, notamment à Athènes, devenue première puissance politique
et économique de la Grèce. L'austérité des formes et des visages fait parler de
sculpture sévère.
Architecture Dans
la construction, le style dorique domine. Un bon exemple est offert par le temple
de Zeus à Olympie, construit vers 460, comportant un péristyle classique à
13 rangées de 6 puissantes colonnes.
Sculpture
 Les sculptures du temple de Zeus sont particulièrement représentatives de cette
période. Le fronton est évoque les préparatifs de la course de chars. La centauromachie
du fronton ouest et certains des travaux d'Héraclès représentés sur les métopes
continuent la tradition des scènes mouvementées.
Les sculptures du temple de Zeus sont particulièrement représentatives de cette
période. Le fronton est évoque les préparatifs de la course de chars. La centauromachie
du fronton ouest et certains des travaux d'Héraclès représentés sur les métopes
continuent la tradition des scènes mouvementées.
L'Aurige de Delphes
(v. 477 av. J.-C. Bronze, hauteur : 1,80 m) est l'une des rares oeuvres de ce
type que l'on ait retrouvée. Il s'agit d'un ex-voto, c'est-à-dire une offrande
dédiée à Apollon dans son temple de Delphes. La sculpture représente un conducteur
de char vainqueur d'une course, et on peut apprécier le rendu du mouvement, la
finesse du portrait et l'intensité du regard.
Dans les représentations humaines,
le poids du corps se porte sur une jambe, au-dessus de laquelle le bassin se relève.
Les femmes portent le péplos, tunique de laine épaisse stricte. La forme humaine
est simple: le profil grec — nez prolongeant le front-, visages souvent impassibles
ou graves.
Peinture et céramique 
Les artistes parviennent à rendre l'émotion
sur les visages et la transparence des draperies, mais la principale innovation
concerne l'espace : au lieu de reposer sur le bord inférieur, les personnages
sont placés à différents niveaux, avec des éléments de décors (bâtiments, végétation).
L'œil n'apparaît plus de face dans les visages de profil, comme c'était le cas
à l'époque archaïque.
Comme les peintres, les décorateurs de vases créent
la profondeur, étagent les personnages, tentent d'exprimer les émotions et créent
un décor polychrome sur fond blanc.
Retour
au MENU
Premier classicisme
(450-400 av. J.-C.)
Architecture
Le premier classicisme est représenté avant tout par les monuments
du Parthénon d'Athènes créés sur l'initiative de Périclès et sous la direction
du sculpteur Phidias sur la colline de l'Acropole (vestiges antérieurs à -1500)
qui domine la ville de 50 m environ.
Les constructions de marbre
du mont Pentélique (au nord d'Athènes), sont réalisées avec un souci extrême
de la perfection technique (inclinaison des colonnes vers l'intérieur pour plus
de stabilité par rapport à la poussée des toits) tout en étant pleines de raffinements.
Les décors des frises révèlent l’extraordinaire virtuosité du drapé, qui tantôt
révèle les formes et tantôt les dérobe au profit d’une animation nerveuse des
étoffes.
Une fois franchis les Propylées (entrée monumentale sous
forme de porche), le Parthénon (vers -440), dorique, domine l'ensemble
par sa masse (69 m sur 31 m) Il abritait la statue colossale d'Athéna Parthénos,
sculptée par Phidias et autre salle renfermait le trésor d'Athènes. Autour de
l'ensemble (y compris un vestibule) se développe un péristyle de 8 colonnes sur
17. Les statues réunies dans les frontons représentent à l'est la naissance d'Athéna
en présence des dieux de l'Olympe, à l'ouest la dispute de la déesse et de Poséidon
pour la possession de l'Attique.
L'Érechthéion (421-407 av. J.-C.),
construit dans un style ionique raffiné, dédié à Athéna Polias, protectrice de
la cité, comporte plusieurs salles mais est célèbre par sa tribune des Caryatides
qui surmonte le tombeau d'un roi mythique dont on reparlera un peu plus loin.
Pour Athéna Niké (victorieuse) a été érigé un temple ionique de
dimensions modestes mais remarquable par sa finesse et sa position au sommet du
bastion sud-ouest de l'Acropole.
Sculpture
Le Style riche qui s'exprime au Parthénon, s'est diffusé. L'une des Sept Merveilles
du monde, malheureusement disparue, était une statue chryséléphantine géante (14 m
en ivoire et argent montés sur une armature en bois) de ZEUS au temple d'Olympie,
réalisée vers 450 av. J.-C. par Phidias, le créateur du style classique auquel
on devait la grande statue d'Athéna Parthénos à Athènes.
En dehors
des sculptures des frises et frontons, beaucoup de statues de cette époque étaient
des bronzes dont peu nous sont parvenus directement. En revanche des copies sur
marbres ont été réalisées plus tard par des artistes romains telles que le Discobole
ou la Vénus Génitrix.
Les représentations masculines s'attachent
à exprimer le canon de la beauté en s'attachant aux proportions du corps humain
tel "le Doryphore" de Polyclète d'Argos de -450 à -440 (la tête représente
1/7 de la hauteur totale du corps) ou à rendre le mouvement tel le Discobole
de Myron de -460 à -450 (on perçoit la dynamique du lancer du disque). Concernant
le rendu de la chevelure, les cheveux courts, bouclés, ont succédé aux "nappes
ciselées" de l’archaïsme.

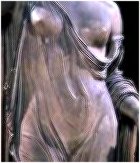
Dans les représentions féminines, partiellement vêtues, dans un style maniéré,
on soigne le drapé avec des plis, nombreux et variés qui s'enroulent autour des
formes pour en souligner le galbe ou dessinent des ondulations qui rendent le
mouvement.C'est le cas des statues-colonnes que sont les 6 "Caryatides"
de la tribune de l'Érechthéion sur l'Acropole (421- 406 av. J.-C.). Quant au "drapé
mouillé", il se caractérise par des vêtements qui collent au corps pour le mettre
en valeur. C'est notamment le cas de la Vénus Génitrix, copie romaine d'un
bronze que l'on attribue à Callimachos (fin du Ve siècle av. J.-C).
Céramique et peinture
C'est
le dernier grand moment de la céramique attique à figures rouges, au travers du
style miniaturiste rivalisant avec celui des sculpteurs: sujets mythologiques
savamment composés, où prédominent les figures féminines donnant lieu à des effets
de drapé tour à tour mousseux et plaqué au corps, qualité extrême du graphisme.
Toutes les femmes (jeunes femmes à leur toilette ou à leurs travaux de filature
et de tissage, joueuse de flûte, fillettes jouant à la balle, préparatifs de mariage)
sont jeunes, jolies, vêtues de tissus précieux dont la transparence révèle le
charme de leur corps notamment par la perfection du drapé mouillé.
D'autres
oeuvres imitent la sculpture du courant maniériste, y compris sur les vases funéraires,
en accentuant la valeur décorative avec un rendu d'étoffes de broderies. La technique
à fond blanc connaît un grand succès tandis que se développe la polychromie par
la maîtrise de la cuisson des pigments bleus et du verts. En parallèle, on note
aussi un retour de la figure rouge sur fond noir.
Dans la peinture de
fresques sur les constructions, les artistes ont résolu les problèmes de la perspective
et du clair-obscur et ils maîtrisent le trompe-l'œil.
Retour
au MENU
Second classicisme
(v. 400-323 av. J.-C.)
La défaite d'Athènes
dans la guerre du Péloponnèse ouvre une période de rivalités entre les cités,
à la faveur desquelles Philippe II, roi de la Macédoine voisine (359-336 av. J.-C.),
réussit à imposer sa domination sur la Grèce (338). Son fils Alexandre (336-323)
conquiert l'Empire perse ; à sa mort, le monde grec comprend l'Égypte et tout
le Proche-Orient, jusqu'à l'Inde. Dans ce monde en transformation, l'art reflète
la diminution du sens communautaire lié à la cité et l'émergence de l'individu,
avec sa sensibilité et ses passions.
Architecture
Dans les temples doriques, les espaces intérieurs se dégagent et s'enrichissent
grâce à des matériaux colorés et au décor, auquel participe le chapiteau corinthien.
Les recherches décoratives concernent en particulier les tholos, édifices ronds,
doriques construites à Delphes (v. -380) et à Épidaure (360-330), ainsi que la
tholos ionique d'Olympie (Philippeion -330).
L'ordre ionique connaît une
renaissance surtout en Asie Mineure (Éphèse vers -330).
Peu après le milieu
du siècle commence la série des tombes macédoniennes qui dure environ deux cents
ans. Creusées sous la terre, elles comportent une voûte en berceau surmontée d'un
tumulus et comprennent une chambre et un vestibule derrière une façade à décor
architectural.
Sculpture
Après une
période marquée par la poursuite du maniérisme, la sculpture retrouve une certaine
sobriété ; elle se distingue du premier classicisme, épris de grandeur, par des
préoccupations plus humaines.
L'Athénien Praxitèle, introduit
dans l'art la jeunesse et la grâce, en portant un intérêt nouveau à la féminité
avec une Aphrodite au bain, première représentation en sculpture de la
déesse nue mais pudique.

Les personnages masculins adoptent une pose plus sinueuse, parfois athétique,
parfois efféminée: modelé moelleux du torse, visage rêveur aux lignes estompées
(sfumato),draperie réaliste, introduction d'éléments naturels dans la composition
(troncs d'arbres).
Dans son Hermès portant Dionysos (marbre de 2,10 m
vers -340) du temple d'Héra à Olympie, Praxitèle, exprime grâce et sensualité.
Le sculpteur Lysippe annonce l'art hellénistique par le traitement
réaliste des mouvements et de la musculature tandis que dans son système de proportion
plus réaliste où la tête équivaut à un huitième de la dimension de la statue lui
donnant une allure plus élancée que dans la période précédente (cf. "Doryphore"
de Polyclète). Travaillant aussi le bronze, on lui attribue l'Ephèbe d'Anticythère
(-340).
Scopas de Paros, également architecte, est réputé pour des
expressions intenses et pathétiques: bouche entrouverte, narines palpitantes,
mais surtout le traitement de la zone des yeux. Comme Praxitèle ou Lysippe, il
inaugure une veine, exploitée à l'époque hellénistique.
Peinture,
mosaïque, céramique
La peinture
grecque atteint son apogée malheureusement beaucoup d'oeuvres de l'époque ont
disparu. Les figures se détachent sur le fond blanc, dessinées d'un trait rapide,
soulignées par des hachures pour rendre les volumes ; la couleur est appliquée
par touches selon une manière qualifiée d'impressionniste. L'ensemble est peu
coloré, mais traduit profondeur et expression.
La mosaïque grecque prend
son essor au IVe siècle av. J.-C. ; réalisée à l'aide de galets naturels, elle
offre un revêtement de sol décoratif comme un tapis et facile à laver.
La
peinture de vases n'est plus guère représentée à Athènes mais davantage en Italie
du Sud. Le décor est souvent surchargé, comme la forme. Les personnages ne sont
plus réservés, mais peints sur le fond noir.
Retour
au MENU
PÉRIODE HELLÉNISTIQUE (V. 323-31 AV. J.-C.)
L'art hellénistique se développe en Grèce et dans l'Orient conquis par Alexandre
le Grand. Après une phase de conflits (v. 323-275 av. J.-C.), les réalisations
les plus originales apparaissent dans les royaumes issus de la division de l'empire
d'Alexandre le Grand (v. 275-150), en particulier Alexandrie en Égypte et Pergame
en Asie Mineure. Des formes mixtes naissent de la rencontre de l'art grec avec
les traditions orientales.
La troisième phase (150-31) correspond à la domination
romaine mais le vaincu subjugue son farouche vainqueur, déjà familier de l'art
grec du fait de la présence de colonies helléniques installées en Italie. Les
artistes romains deviennent les émules.
Les progrès dans l'imitation de la
réalité (mimésis) en constituent l'apport majeur, mais l'art est aussi marqué
par une tendance tournée vers le passé. Ce style réaliste a un retentissement
considérable, puisqu'on le décèle jusqu'en Chine.
Architecture,
urbanisme L'architecture des temples montre une évolution,
surtout à partir du IIe siècle. Ils deviennent plus petits et leur plan traduit
une tendance à accentuer la façade. Au lieu d'être au centre d'un espace, visibles
sous toutes les faces, avec une mise en scène du temple dominant un complexe impressionnant
de terrasses et d'escaliers (îles de Rhodes et de Kos). Des sanctuaires spécialement
aménagés sont prévus pour les divinités orientales.
Les ordres s'adaptent
à des effets nouveaux. Les colonnes ioniques très espacées traduisent une recherche
de légèreté qui entraîne aussi la diminution de la hauteur de l'entablement. Dans
l'ordre dorique, les colonnes deviennent minces, presque sans galbe ; on compte
3 métopes par entrecolonnement à l'entablement des temples (au lieu de 2 antérieurement).
La partie inférieure du fût peut rester lisse tandis que, dans le haut, les cannelures
laissent la place à des facettes. Désormais, l'ordre dorique et l'ordre ionique
se combinent dans les colonnades extérieures et le chapiteau corinthien se répand
dans le péristyle des temples.

Les édifices cultuels perdent leur primauté au profit de l'architecture fonctionnelle,
représentée par des bâtiments publics liés à la vie sociale, situés en majorité
autour de l'agora. Un édifice remplit presque toutes les fonctions : le portique.
Souvent de grande dimension, à plusieurs nefs et à étage, il peut abriter des
salles contre le mur du fond. Pratique, il joue également un grand rôle esthétique,
conférant un aspect monumental aux espaces qu'il borde, aussi bien dans les sanctuaires
qu'en ville. Des portiques dignes d'une capitale apparaissent à l'époque hellénistique
sur l'agora d'Athènes.
Des installations spécifiques comprennent des
salles de réunion destinées aux assemblées et équipées de gradins, des tribunaux,
des théâtres, du type de celui d'Épidaure (v. -300), des bibliothèques, dont les
plus célèbres se trouvaient à Pergame et à Alexandrie.
Pour l'hygiène
et le sport se multiplient des bains, des stades, des gymnases avec des pistes
aériennes et couvertes et des palestres, ensembles de salles autour d'une cour
à péristyle et cadres d'activités culturelles autant que physiques. S'y ajoutent
des installations liées à l'artisanat, à l'industrie et au commerce. Le phare
d'Alexandrie, installé dans l'île de Pharos, compte parmi les Sept Merveilles
du monde.
Des villes nouvelles, au plan régulier (sosu réserve d'adaptation
au relief) s'accompagnent de belles demeures témoignant de l'enrichissement des
particuliers. Elles comportent un péristyle autour de la cour intérieure et des
pièces variées: salles de réception, salle à manger, cuisine, salle de bains,
latrines, chambres et appartements des femmes à l'étage ; des locaux indépendants
servant de boutiques s'ouvrent sur la rue.
La fonction royale entraîne la
construction de palais. Des villes de plus en plus nombreuses s'entourent de remparts.
Sculpture
La sculpture renonce à privilégier
la beauté et représente sans restriction les âges, les activités, les conditions
sociales et les races. Elle explore la sensibilité et la conscience, traite de
l'amour et de la souffrance mais aussi des états particuliers comme l'ivresse
et le sommeil. L'intérêt pour l'individu bénéficie avant tout au portrait.
Sur ce courant réaliste se greffent un goût pour l'exotisme et une veine qualifiée
de rococo qui met l'accent sur les sujets mineurs, charmants ou bizarres, essentiellement
décoratifs. Le baroque est la plus impressionnante des nouvelles formes de goût
(École de Rhodes - Victoire de Samothrace, v. 190 av. J.-C.).
L'admiration
pour l'art du passé s'accompagne de la constitution de collections et de la production
de copies et d'œuvres dérivées, en particulier à la demande des Romains (par exemple
la Vénus de Milo (v. 100 av. J.-C., musée du Louvre).
Peinture
et autres arts
Remplaçant les pavements et mosaïque
de galets, l'emploi de tesselles, petits cubes de pierre et d'autres matériaux
colorés, permit une réalisation plus raffinée et plus réaliste des motifs des
mosaïques grâce aux variations de couleurs permettant de créer l'illusion du relief.
La peinture dont peu de traces subsistent, atteint la plénitude de ses
moyens avec des thèmes très variés: mythologie, religion, histoire, scènes de
la vie ordinaire, natures mortes, paysages champêtres...
Une forme de décoration
murale imitant une construction luxueuse se développe avec l'emploi de stuc modelé
et coloré sur les parois mais la perspective géométrique reste imparfaite car
toutes les lignes ne convergent pas vers un point de fuite unique.
Dès la période hellénistique, vers -300, l'usage
de la voûte et de l'arc se développent dans l'architecture. Deux siècle plus tard,
lorsque l'ancien monde grec est dominé par Rome, l'usage de la voûte, de l'arc
en plein cintre et d'une autre innovation, le béton (opus cæmenticum, mortier
et agrégats à base de chaux, sable et brique pilée), vont conduire à des ruptures
(dissociation entre forme et structure) avec la tradition architecturale grecque
ou à des hybridations.
L'Empire byzantin reprendra pour partie l'héritage,
puis ce sera le tour du Moyen-Age roman en Occident, après les invasions barbares...
Notre époque reconnaît la richesse et la virtuosité de l'art hellénistique,
longtemps jugé décadent et même méprisé, mais apprécie surtout l'art archaïque
d'où exhalent la fraîcheur et la vie.
| Les
apports orientaux | |


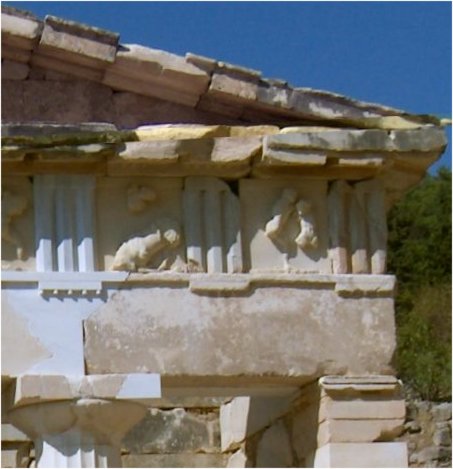
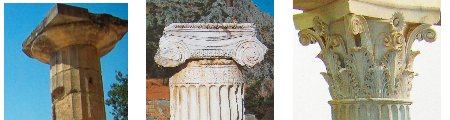
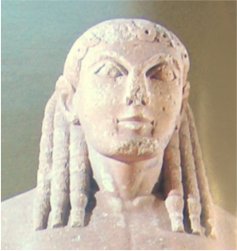
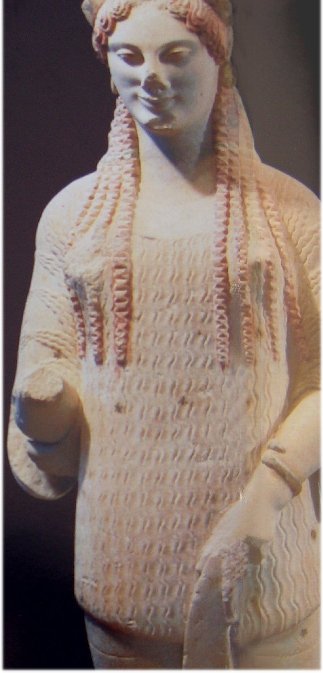 Le kouros, qui apparaît vers la fin du VIIe siècle, dérive de modèles égyptiens
mais la fabrication en série permet une maîtrise de la technique des sculpteurs
caractérisée par un meilleur rendu de l'anatomie.
Le kouros, qui apparaît vers la fin du VIIe siècle, dérive de modèles égyptiens
mais la fabrication en série permet une maîtrise de la technique des sculpteurs
caractérisée par un meilleur rendu de l'anatomie.  Les vases attiques, appréciés pour leur forme et leur décor, prennent la place
de la céramique corinthienne qui dominait lors de la période précédente.
Les vases attiques, appréciés pour leur forme et leur décor, prennent la place
de la céramique corinthienne qui dominait lors de la période précédente.  Les sculptures du temple de Zeus sont particulièrement représentatives de cette
période. Le fronton est évoque les préparatifs de la course de chars. La centauromachie
du fronton ouest et certains des travaux d'Héraclès représentés sur les métopes
continuent la tradition des scènes mouvementées.
Les sculptures du temple de Zeus sont particulièrement représentatives de cette
période. Le fronton est évoque les préparatifs de la course de chars. La centauromachie
du fronton ouest et certains des travaux d'Héraclès représentés sur les métopes
continuent la tradition des scènes mouvementées.